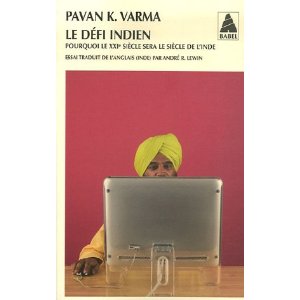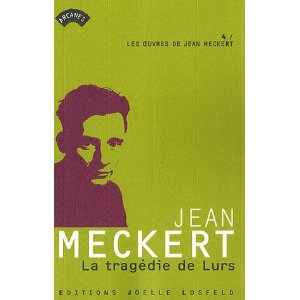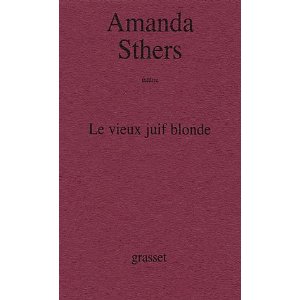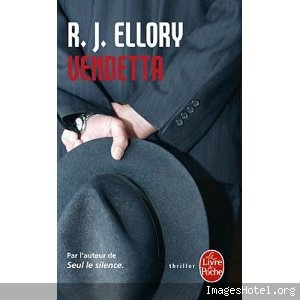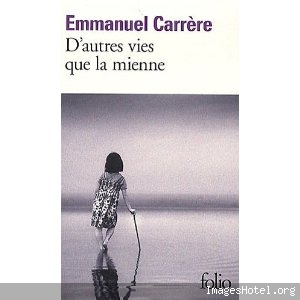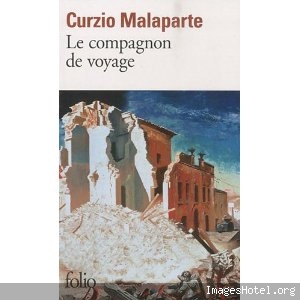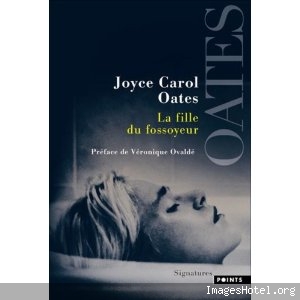Cette vie – Karel Schoeman
 Dans la pénombre de sa chambre, une femme se meurt. Au cours de sa vie, elle a beaucoup vu, beaucoup entendu : elle a surtout énormément appris du cœur des hommes. Elle était la jeune fille qu'on ne regarde pas. Celle, discrète, dont on oublie la présence. Celle qui écoute, qui observe. Celle qui se souvient. Au crépuscule de sa vie, elle égrène les images oppressantes de son passé et, ce faisant, exhume tout un monde, celui des Afrikaners du début du XIX e siècle. Surgissent alors de sa mémoire, sur fond de paysage tissé par le vent, la poussière et le silence, des êtres austères et néanmoins secrètement ardents, pragmatiques puis brusquement lyriques.
Dans la pénombre de sa chambre, une femme se meurt. Au cours de sa vie, elle a beaucoup vu, beaucoup entendu : elle a surtout énormément appris du cœur des hommes. Elle était la jeune fille qu'on ne regarde pas. Celle, discrète, dont on oublie la présence. Celle qui écoute, qui observe. Celle qui se souvient. Au crépuscule de sa vie, elle égrène les images oppressantes de son passé et, ce faisant, exhume tout un monde, celui des Afrikaners du début du XIX e siècle. Surgissent alors de sa mémoire, sur fond de paysage tissé par le vent, la poussière et le silence, des êtres austères et néanmoins secrètement ardents, pragmatiques puis brusquement lyriques.
Presque mort – Ake Edwardson
Un gangster, un écrivain, un politicien et un citoyen ordinaire - sans compter le commissaire Winter rongé par le doute et par un mal de tête persistant. L'automne est particulièrement beau mais tous sont rattrapés par un sombre événement. Leurs destins se rejoignent autour de la mystérieuse disparition d'une jeune fille, trente ans auparavant. Presque mort est le neuvième et avant-dernier roman de la série d'Ake Edwardson.
L'Amour à Versailles – Alain Baraton
A. Baraton, jardinier en chef du parc de Versailles, invite à une promenade amoureuse au cœur du château de Versailles. Il fait revivre les soupirs, secrets d'alcôves, fous rires, chagrins d'amour, à travers les figures de Louis XV, de Mme de Maintenon ou encore de Marie-Antoinette.
Vendetta – R.J. Ellory
2006, La Nouvelle-Orléans. Catherine, fille du gouverneur de Louisiane, est enlevée. Son garde du corps est assassiné. L'enquête est confiée au FBI. Très vite, le kidnappeur, Ernesto Perez, se 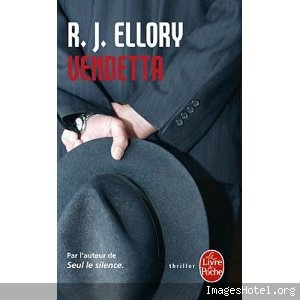 livre aux autorités... Il veut s'entretenir avec Ray Hartmann, un obscur fonctionnaire qui travaille à Washington dans une unité chargée de la lutte contre le crime organisé. C'est le début d'une longue confrontation entre les deux hommes jusqu'à l'étonnant coup de théâtre final.
livre aux autorités... Il veut s'entretenir avec Ray Hartmann, un obscur fonctionnaire qui travaille à Washington dans une unité chargée de la lutte contre le crime organisé. C'est le début d'une longue confrontation entre les deux hommes jusqu'à l'étonnant coup de théâtre final.
Faut-il brûler la Galigaï ? – Pierre Combescot
" Bouclée par les soins de Léonora rengorgée dans sa vanité, donnant sa main à baiser comme la Vierge accorde son pardon, Marie fait la reine. Léonora la regarde et rit sous cape. Elle observe aussi tous les gentilshommes qui se pressent autour d'elle. Léonora aperçoit dans la foule Concini. La moustache retroussée, le front haut, le nez droit et fort. Saisit-elle dans son regard ce côté dur, presque inquiétant ? Son cœur bat. Le soir même, elle se rend chez un notaire derrière les Offices. Son vieil ami Bardo Galigaï bat de l'aile et sa famille s'éteindra avec lui. Or à Florence, il est de Coutume de racheter un nom. Le lendemain, Léonora apporte l'argent. Où l'a-t-elle pris ? Sans doute est-ce Marie qui le lui a donné. Quoi qu'il en soit, dès que le vieux grigou aura passé, elle deviendra Léonora Galagaï. " Voici le récit d'une fulgurante ascension. Comment une simple blanchisseuse, se rendant indispensable à la future Marie de Médicis, devient-elle marquise d'Ancre puis maréchale de France ? Le destin exceptionnel de cette intrigante de haut vol nous fait revivre les crimes et les passions de la Cour des Médicis et du trône de France. Meurtres, trahisons, complots, secrets d'alcôve n rythment cette magnifique épopée sombre et sanglante.
Le premier amour – Sandor Marai
Dans une petite ville de la province hongroise, un respectable professeur de latin mène une vie terne et solitaire, dénuée de surprise. Lorsqu'il entreprend de tenir son journal, pour " faire passer le temps ", cette apparente tranquillité vole en éclats. Au fur et à mesure qu'il confie les menus faits et gestes de ses journées, des bribes de souvenirs d'enfance lui reviennent, la glace qui recouvrait ses émotions se craquelle, et sa propre vérité surgit enfin. Cette première fêlure en annonce une autre, qui va faire basculer sa vie : un premier amour, violent, tardif, ravageur...
Miss Mackenzie – Anthony Trollope
"Et voilà que se présentait un soupirant qui n'était ni vieux ni fatigué, qui lui était personnellement agréable, avec qui elle aurait pu goûter quelques-uns des plaisirs romanesques du monde. Devrait-elle le prendre ? Elle savait bien qu'il y avait des inconvénients. Elle n'avait pas manqué de remarquer les imperfections de cet homme [...]. Mais pourquoi aurait-il dû être parfait puisqu'elle était elle-même consciente de ses propres imperfections ? [...] Néanmoins, elle était ambitieuse. Ne pourrait-elle trouver mieux encore que Mr Rubb ?" Nous sommes dans l'Angleterre victorienne. Margaret Mackenzie, vieille fille de 35 ans, reçoit tout à coup un bel héritage. Bientôt les prétendants se pressent... Désemparée, elle hésite entre son cousin John Ball, veuf et père d'une nombreuse famille ; Samuel Rubb, l'associé de son frère, quelque peu filou ; et le révérend Maguire, qui aurait été si beau sans son œil défectueux. La situation se complique lorsque l'héritage est remis en cause... Il va falloir à Miss Mackenzie beaucoup de sang-froid pour sonder son cœur et éviter les pièges qu'on lui tend.
D'autres vies que la mienne – Emmanuel Carrère
À quelques mois d'intervalle, la vie m'a rendu témoin des deux événements qui me font le plus peur au monde : la mort d'un enfant pour ses parents, celle d'une jeune femme pour ses enfants et son 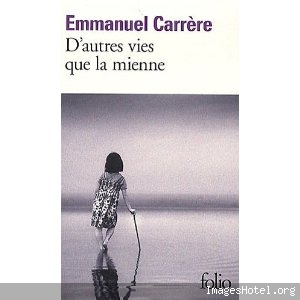 mari. Quelqu'un m'a dit alors : tu es écrivain, pourquoi n'écris-tu pas notre histoire? C'était une commande, je l'ai acceptée. C'est ainsi que je me suis retrouvé à raconter l'amitié entre un homme et une femme, tous deux rescapés d'un cancer, tous deux boiteux et tous deux juges, qui s'occupaient d'affaires de surendettement au tribunal d'instance de Vienne (Isère). Il est question dans ce livre de vie et de mort, de maladie, d'extrême pauvreté, de justice et surtout d'amour. Tout y est vrai.
mari. Quelqu'un m'a dit alors : tu es écrivain, pourquoi n'écris-tu pas notre histoire? C'était une commande, je l'ai acceptée. C'est ainsi que je me suis retrouvé à raconter l'amitié entre un homme et une femme, tous deux rescapés d'un cancer, tous deux boiteux et tous deux juges, qui s'occupaient d'affaires de surendettement au tribunal d'instance de Vienne (Isère). Il est question dans ce livre de vie et de mort, de maladie, d'extrême pauvreté, de justice et surtout d'amour. Tout y est vrai.
L'homme qui m'aimait tout bas – Éric Fottorino
Mon père s'est tué d'une balle dans la bouche le 11 mars 2008. Il avait soixante-dix ans passés. J'ai calculé qu'il m'avait adopté trente-huit ans plus tôt, un jour enneigé de février 1970. Toutes ces années, nous nous sommes aimés jusque dans nos différences. Il m'a donné son nom, m'a transmis sa joie de vivre, ses histoires de soleil, beaucoup de sa force et aussi une longue nostalgie de sa Tunisie natale. En exerçant son métier de kinésithérapeute, il travaillait " à l'ancienne ", ne s'exprimait qu'avec les mains, au besoin par le regard. Il était courageux, volontaire, mais secret : il préféra toujours le silence aux paroles, y compris à l'instant ultime où s'affirma sa liberté, sans explication. " Ce sont les mots qu'ils n'ont pas dits qui font les morts si lourds dans leur cercueil ", écrivit un jour Montherlant. Mais il me laissa quand même mes mots à moi, son fils vivant, et ces quelques pages pour lui dire combien je reste encore avec lui.
L'ennemi déclaré – Jean Genet
Articles, entretiens, déclarations, préfaces, manifestes ou discours, les textes des interventions de Genet, ici rassemblés, témoignent d'un paradoxe : celui qui fut l'écrivain le plus solitaire, le plus retranché de son temps fut aussi, durant les vingt dernières années de sa vie, l'un des plus présents sur la scène publique. De Chartres à Chicago, de la Goutte-d'Or au camp de Chatila, des rives du Jourdain aux ghettos noirs d'Amérique, ce livre retrace l'aventure littéraire et politique, menée aux frontières de l'Occident, aux côtés des exclus du monde et des peuples en révolte, par un poète qui n'a jamais revendiqué d'autre titre que celui de vagabond.
Le compagnon de voyage – Curzio Malaparte
Fable pudique, baroque et pleine d'humanité, Le Compagnon de voyage a pour cadre l'Italie de 1943. Après le renversement de Mussolini et le chaos que provoque la signature de l'armistice, les hommes de troupe, désormais sans ordres et sans chefs,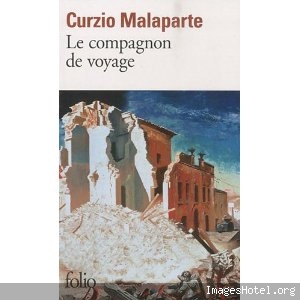 décident de rentrer chez eux. Au milieu de celle débandade, Calusia, un soldat bergamasque, entame la lente remontée de la Péninsule jusqu'à Naples. Il s'est juré de rendre à sa famille la dépouille de son lieutenant, mort en Calabre lors des ultimes combats désespérés et vains contre le débarquement allié. Cet honnête paysan, fier de ses origines, traverse l'Italie en compagnie de l'aîné Roméo et d'une jeune fille qu'il a prise sous sa protection. A travers ses rencontres se dessine un portrait tout en finesse du peuple italien, capable des pires bassesses, mais aussi plein de courage et de générosité.
décident de rentrer chez eux. Au milieu de celle débandade, Calusia, un soldat bergamasque, entame la lente remontée de la Péninsule jusqu'à Naples. Il s'est juré de rendre à sa famille la dépouille de son lieutenant, mort en Calabre lors des ultimes combats désespérés et vains contre le débarquement allié. Cet honnête paysan, fier de ses origines, traverse l'Italie en compagnie de l'aîné Roméo et d'une jeune fille qu'il a prise sous sa protection. A travers ses rencontres se dessine un portrait tout en finesse du peuple italien, capable des pires bassesses, mais aussi plein de courage et de générosité.
La maison du silence – Orhan Pamuk
Un tout petit port turc, désert l'hiver, envahi par les touristes l'été. A l'écart des luxueuses villas des nouveaux riches, une maison tombant en ruine. Un nain y veille sur une très vieille femme, qui passe ses jours et ses nuits à évoquer sa jeunesse et à ressasser ses griefs. Ils vivent côte à côte dans le silence sur les secrets qu'ils partagent, dans la haine et la solitude. Comme chaque été, les trois petits-enfants de la vieille dame viennent passer quelques jours chez elle : un intellectuel désabusé et alcoolique, une étudiante progressiste et idéaliste, un lycéen arriviste, rêvant de la réussite à l'américaine. Leur séjour sera bref et se terminera par un drame, causé autant par les conditions politiques des années 1975-1980 que par le passé de la famille. Le récit dresse un tableau lucide de l'histoire des cent dernières années de la Turquie qui pose adroitement une question très actuelle pour les pays du Proche-Orient : l'occidentalisation a-t-elle échoué ? Quels en ont été les résultats, quelle est la part de cette évolution dans les conflits de générations comme dans les rapports droite-gauche en politique ? Un beau roman. Un écrivain sensible, qui sait raconter une histoire.
Le faucheux – James Sallis
A la Nouvelle-Orléans, on peut se réveiller dans un hôpital et y être comme dans une prison. On peut être payé par des membres des droits civiques pour retrouver une jeune femme jamais descendue d'un avion, enquêter sur la disparition d'une gamine parfaite puis, dans la foulée, devenir l'écrivain de sa propre vie. Lew Griffin, privé black, ancien soldat discrètement remercié, amant d'une prostituée de grande classe, est un solitaire épris de justice. Compassion, désespoir et violence vibrent en lui. Dans une ville comme la Nouvelle-Orléans où les crimes sont aussi nombreux que les cafards, ville blanche et noire de tout les possibles, Griffin voit chaque jour le chaos se mêler à l'espoir. Il est, dans ses rues, un fauve au cœur ouvert : un homme qui se bat et refuse l'inexorable.
La convocation – Herta Müller
Elle n'entend plus qu'un mot : Convocation. Depuis son passage à l'usine de confection où elle a glissé un SOS dans la doublure d'un vêtement de luxe qu'elle cousait pour une maison italienne, ils ne la lâchent plus. Chaque semaine, chaque jour, leur rendre des comptes, élaborer des scénarios pour répondre à leurs questions, se justifier, s'entraîner à supporter la douleur, ne pas perdre la tête Dans le tramway qui la mène au bureau de la Securitate, où elle a de nouveau été convoquée, la narratrice lutte contre l'angoisse qui la submerge et le sentiment d'humiliation mentale que son tortionnaire va s'ingénier à provoquer. Elle doit résister.
Roumanie années Ceausescu : la dictature pèse sur le pays comme une chape de plomb. Le pouvoir surveille les moindres gestes, contrôle toute activité culturelle ou toute forme d'expression artistique, jusqu'à rendre fous aussi bien les surveillés que les surveillants. Herta Müller nous transmet l'expérience de cette dictature et de la peur qu'elle provoque en chacun de ceux qu'elle tente d'éliminer. Son écriture serrée et la force de son langage font de son roman un témoignage et un poème nerveux et inquiétant. Une forme esthétique de la résistance, celle de la dernière génération d'écrivains roumains de langue allemande, confrontés à l'isolement de la dictature et à l'abîme de l'exil.
La fille du fossoyeur – Joyce Carol Oates
En 1936, une famille d'émigrants fuyant désespérément l'Allemagne nazie, les Schwart, échoue dans une petite ville du nord de l'état de NY où le père, un ex-professeur de lycée ne se voit offrir qu'un seul job : celui de fossoyeur-gardien de cimetière. Humiliation, pauvreté, frustrations quotidiennes portent en elles les germes de l'épouvantable tragédie dont Rebecca la benjamine des trois enfants sera le témoin. Prémices de l'étonnante aventure à multiples rebonds que va devenir très vite la vie de Rebecca, contrainte à une fuite en avant pour échapper entre autres à un mari abusif et dangereux, et protéger son petit garçon ; mais une fuite qui est aussi une quête émouvante née du désir profond, quoique inconscient chez la jeune femme, de retrouver une sorte d'appartenance à ce même cruel passé, de se rattacher en fin de compte à sa véritable identité. Ce que le destin ne lui 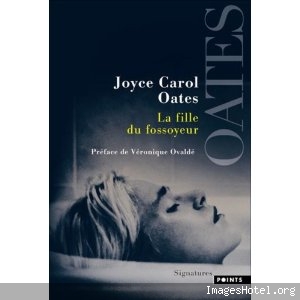 permettra qu'au terme d'une existence d'intranquillité. L'apprentissage des hommes, du mariage, de la maternité, le combat d'une femme pour son indépendance dans la société américaine de l'après-guerre font de ce livre le plus magnifique des hymnes à la survie et à la résilience humaine. Peut-être l'inspiration exceptionnelle qui anime ces pages est-elle due en partie à Blanche Morgensten, la grand-mère de l'auteur, qui a servi au départ de modèle à l'héroïne. Comme Rebecca en effet, Blanche était la fille d'un immigrant juif allemand devenu fossoyeur qui, un beau jour, attaqua brutalement sa femme avant de se tirer une balle dans la tête. Et comme Rebecca, Blanche mariée en premières noces à un ivrogne qui la battait, s'était retrouvée seule à élever son fils, le père de JCO. Le reste de cet extraordinaire roman n'étant plus alors que (superbe) littérature...
permettra qu'au terme d'une existence d'intranquillité. L'apprentissage des hommes, du mariage, de la maternité, le combat d'une femme pour son indépendance dans la société américaine de l'après-guerre font de ce livre le plus magnifique des hymnes à la survie et à la résilience humaine. Peut-être l'inspiration exceptionnelle qui anime ces pages est-elle due en partie à Blanche Morgensten, la grand-mère de l'auteur, qui a servi au départ de modèle à l'héroïne. Comme Rebecca en effet, Blanche était la fille d'un immigrant juif allemand devenu fossoyeur qui, un beau jour, attaqua brutalement sa femme avant de se tirer une balle dans la tête. Et comme Rebecca, Blanche mariée en premières noces à un ivrogne qui la battait, s'était retrouvée seule à élever son fils, le père de JCO. Le reste de cet extraordinaire roman n'étant plus alors que (superbe) littérature...
 "If your pictures aren't good enough, you aren't close enough" (si vos photos ne sont pas bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez près).
"If your pictures aren't good enough, you aren't close enough" (si vos photos ne sont pas bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez près). l'homme fait face au danger, prend des risques, se met en péril, devient authentique, sincère, fait face à la mort souvent. C'est pourquoi les photos les plus représentatives sont souvent approximatives, floues et mal cadrées. Il obtiendra la renommée grâce à une photo célèbre, intitulée "Mort d'un soldat républicain". Elle sera le symbole de la guerre d'Espagne, même si cette image reste sujette à caution aujourd'hui encore. Beaucoup de spécialistes se demandant si celle-ci est une reconstitution d'une réalité vue, ou bien une photo prise sur le vif. Gerda Taro tombera pendant la guerre d'Espagne sur le front, en 1937. Robert Capa ne se remettra jamais complètement de cette disparition. En 1938, Robert Capa est envoyé par Life sur le conflit sino-japonais. La même année, il est couronné plus grand reporter de guerre du monde. Entre la guerre d'Espagne et la 2ème Guerre Mondiale, Robert Capa va se consacrer à des sujets plus légers. Il abordera des thèmes comme le pèlerinage de Lisieux ou le Tour de France, pour Match ou Paris Soir.
l'homme fait face au danger, prend des risques, se met en péril, devient authentique, sincère, fait face à la mort souvent. C'est pourquoi les photos les plus représentatives sont souvent approximatives, floues et mal cadrées. Il obtiendra la renommée grâce à une photo célèbre, intitulée "Mort d'un soldat républicain". Elle sera le symbole de la guerre d'Espagne, même si cette image reste sujette à caution aujourd'hui encore. Beaucoup de spécialistes se demandant si celle-ci est une reconstitution d'une réalité vue, ou bien une photo prise sur le vif. Gerda Taro tombera pendant la guerre d'Espagne sur le front, en 1937. Robert Capa ne se remettra jamais complètement de cette disparition. En 1938, Robert Capa est envoyé par Life sur le conflit sino-japonais. La même année, il est couronné plus grand reporter de guerre du monde. Entre la guerre d'Espagne et la 2ème Guerre Mondiale, Robert Capa va se consacrer à des sujets plus légers. Il abordera des thèmes comme le pèlerinage de Lisieux ou le Tour de France, pour Match ou Paris Soir. Capa marche sur une mine. C'était le 25 mai 1954.
Capa marche sur une mine. C'était le 25 mai 1954.