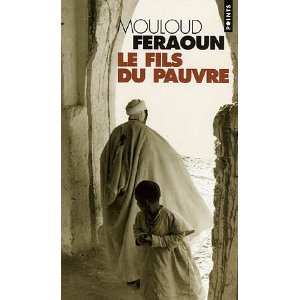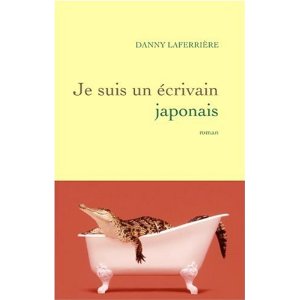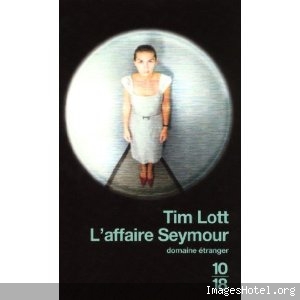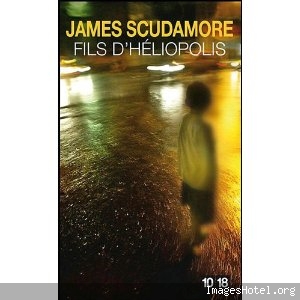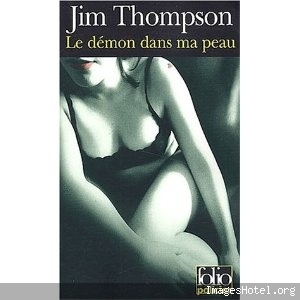- Ida - Irène Némirovsky - Folio 2€
 Deux nouvelles pour raconter les artifices de l'existence. Deux nouvelles pour deux destins douloureux de femmes à la vie diamétralement opposées.
Deux nouvelles pour raconter les artifices de l'existence. Deux nouvelles pour deux destins douloureux de femmes à la vie diamétralement opposées.
"Elle apparaît au faîte d'un escalier de trente marches d'or, comme cinq ou six autres femmes, tous les soirs, dans les music-halls de Paris, elle descend entre les girls nues, coiffées d'un chaperon de roses, qui tiennent à la main, chacune, un parasol d'or. Des pendeloques de verre, des pierres taillées, des miettes de miroir entourent son visage ; un long manteau tissé d'or, des perles et des plumes la couvrent. C'est une femme, qui, depuis longtemps, n'est plus jeune ; ses jambes sont belles encore, mais elle porte sur les seins un corselet de pierreries, car il faut bien que tout s'use …". Ida Sconin, célèbre meneuse de revue parisienne continue malgré son âge à éblouir ses admirateurs et à étouffer ses rivales. Pourquoi une femme de cet âge continue-t-elle à se pavaner avec plumes et strass tous les soirs, alors que les plus jeunes pourraient tenir son rôle dans la revue ? Qu'a-t-elle donc de plus que les autres ? Pourquoi est-elle toujours aussi souple et élancée ? Les femmes qui assistent au spectacle l'envient, lui en veulent d'avoir des jambes aussi fines et un ventre aussi plat. Ida Sconin fait fantasmer les hommes, alors qu'ils ne remarquent plus leurs épouses depuis de nombreuses années. Paris et les parisiens l'admirent, même s'ils ne lui ont jamais donné leur cœur. Parce qu'Ida Sconin est une étrangère. Elle a fait rêver immédiatement après la guerre, quand les hommes ont voulu en finir avec les temps incertains et douloureux. Elle n'est pas aimée, elle le sait et s'en moque. « Elle éblouit, elle obsède Paris et la province. Dans de tranquilles sous-préfectures, devant l'hôtel de ville, endormi, on entend sa voix fixée sur les disques chanter Mon bel amour. Sur les murs de Paris, son image apparaît à chaque tournant de rue ; debout, demi-nue, sur un escalier d'or, la tête dressée sous l'amas de plumes d'autruche ; son nom étincelle, spasmodiquement éteint et rallumé à travers le doux brouillard lumineux des soirs de Paris ».
Ida s'est imposée dans le milieu de la nuit et compte bien y rester le plus longtemps possible, n'en déplaise aux nymphettes qui lui servent de faire-valoir chaque soir en la mettant en valeur par leurs gestes amples et délicats. Ida barre la route aux plus jeunes danseuses, pressées d'arriver en haut de l'affiche. Chacune guette sa place. Chacune attend l'instant où elle trébuchera, où l'âge ne fera plus illusion. Elles ont bien remarqué qu'Ida se fatiguait, vieillissait, que le sourire était voilé, de plus en plus contraint, crispé, que les rides paraissaient sous le fard, que les cheveux blanchissaient malgré les colorations. Qu'importe. La meneuse de revue c'est encore et toujours elle, parce qu'Ida Sconin fait recette. « - Ida Sconin fait recette. Parole magique : elle le sait. La seule qui barre la route à ces jeunes femmes brutales, pressées, aux dents longues, qui, toutes, guettent, depuis des années, sa place, n'attendent qu'un faux-pas, un fléchissement, un jour de maladie ou de fatigue, le moment où l'âge si longtemps vaincu, la terrassera à son tour ».
Seulement, Ida se leurre. Mais elle sait par où elle a dû passer pour en arriver là. Elle a connu les humiliations, les bassesses, le mépris, la prostitution même. Elle se dupe en faisant des efforts quasi surhumains, en s'imposant de vraies tortures physiques pour arriver à un piètre résultat. "Elle se sent triste. Car elle a beau farder son visage, taillader ses seins et ses joues, masser son front, effacer tous les jours les rides, qui, toutes les nuits, inlassablement, se reforment, elle ne peut s'empêcher que son âme, par moment, s'essouffle et se fatigue plus vite que son corps". Pour faire tenir ce corps, ce cœur qui vieillit plus qu'elle ne le souhaitait, elle double, triple la dose de véronal. Au moins, avec le sommeil, les problèmes disparaissent un instant. Mais voilà que le directeur de L'Impérial veut lui imposer cette Cynthia, ce corps dénudé de vingt ans, beau, frais, naturel, sculptural, dans son nouveau spectacle. Ida comprendra bientôt que l'heure de vérité a sonné, que  la fin est arrivée. Elle prend conscience qu'elle est une femme vieillie qui s'est reniée, qui a renoncé à tout, même à l'amour, juste par égocentrisme.
la fin est arrivée. Elle prend conscience qu'elle est une femme vieillie qui s'est reniée, qui a renoncé à tout, même à l'amour, juste par égocentrisme.
« Au bout de la rue, une usine s'élève, petite et modeste comme la ville elle-même ; l'unique cheminée souffle tranquillement un peu de fumée grise et légère que le vent disperse ». Madeleine, jeune fille de bonne famille vit dans une petite ville du Nord de la France. Issue de cette bourgeoisie provinciale et bigote, son univers se limite aux frontières familiales. Au cours d'un dîner chez sa tante, Madeleine rencontre un jeune homme poli, bien éduqué, du même milieu social, Henri Bertrand, jeune ingénieur plein d'avenir. Madeleine est un peu indécise. Elle ne sait pas s'il lui plait vraiment. Il la trouve charmante et il aime ses cheveux. Et puis, ce mariage arrangerait tout le monde. M. Henri deviendrait l'associé de son beau-père, la moitié de la dot resterait dans l'affaire et Madeleine continuerait d'habiter la maison familiale. « La mère dit : - Nous ne voulons pas t'influencer, ma petite fille …. Mais c'est un bon parti. Un honnête garçon, bien élevé, qui te rendra heureuse. Nous ne voulons que ton bonheur. – Nous ne voulons que ton bonheur, répète le père avec force ».
D'un coup, tout est fixé. Les fiançailles, le mariage et le voyage de noces en suivant afin que tous profitent des festivités, même la grand-tante Moulins à la santé vacillante. Tout est beau, merveilleux, propre, lisse, sans aspérités, sans failles. La façade est splendide, à l'aune de cette bourgeoisie bien-pensante et pieuse, persuadée d'entretenir les traditions et les bonnes manières. Un simple grain de sable et les rouages de cette machine trop parfaite se grippe, dérape et déraille. Le jour de son mariage, Madeleine apprend qu'Henri n'est pas tout à fait un jeune homme fréquentable. Parce qu'Henri avait une vie parallèle, ailleurs, avec une jeune femme sans le sou à qui il avait promis le mariage. M. Henri aura d'autres vies parallèles avec de jeunes ouvrières de l'usine. Toujours, Madeleine fermera les yeux sur ses incartades, acceptera toutes les compromissions pour sauver les apparences.
« Ida », suivi de « La comédie bourgeoise » d'Irène Némirovsky où le destin poignant  de deux femmes que la vie – dans son immense cruauté – n'épargnera pas. « Ida », où la revanche d'une petite russe immigrée. « Ida », celle qui refuse de vieillir, de céder sa place parce qu'elle a trop attendu cet instant de gloire éphémère de voir les hommes à ses pieds. « Ida », déboulonnée par la jeunesse et la fraîcheur et qui comprendra trop tard le ridicule et la crédulité de son comportement. Madeleine de « La comédie bourgeoise » qui tolérera tout avec l'abnégation d'une sainte promise au martyr. Ces deux femmes ont une communauté de destin qu'elles n'ont pas choisie. Il leur a été imposé par leur entourage, leur histoire personnelle ou intime. Ida comme Madeleine n'ont jamais pu ou voulu influer sur le cours de leur existence, les broyant inexorablement, ne leur laissant que des chimères pour raison d'être. C'est une peinture amère de la vie, telle qu'on la trouve aux hasards des destins de chacun.
de deux femmes que la vie – dans son immense cruauté – n'épargnera pas. « Ida », où la revanche d'une petite russe immigrée. « Ida », celle qui refuse de vieillir, de céder sa place parce qu'elle a trop attendu cet instant de gloire éphémère de voir les hommes à ses pieds. « Ida », déboulonnée par la jeunesse et la fraîcheur et qui comprendra trop tard le ridicule et la crédulité de son comportement. Madeleine de « La comédie bourgeoise » qui tolérera tout avec l'abnégation d'une sainte promise au martyr. Ces deux femmes ont une communauté de destin qu'elles n'ont pas choisie. Il leur a été imposé par leur entourage, leur histoire personnelle ou intime. Ida comme Madeleine n'ont jamais pu ou voulu influer sur le cours de leur existence, les broyant inexorablement, ne leur laissant que des chimères pour raison d'être. C'est une peinture amère de la vie, telle qu'on la trouve aux hasards des destins de chacun.
D'autres blogs en parlent : Cécile QD9, Tamara, Lou, Bossanova52 ... D'autres peut-être ?! Merci de vous faire connaître par un petit commentaire que je vous ajoute à la liste.