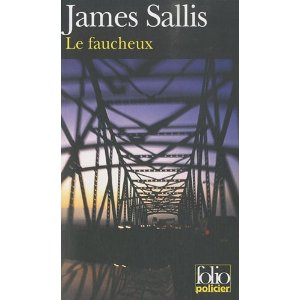"Alors que nous avançons vers la terre, dans la pâleur grise de l'aube, l'embarcation de fer ressemble à un cercueil de 12 mètres, prenant des paquets d'eau verte qui retombent sur les têtes casquées des hommes serrés épaule contre épaule, dans l'inconfortable, l'insupportable, la dure solitude des soldats allant au combat » (Ernest Hemingway – 6 juin 1944). Il y a si longtemps déjà, que – parfois - notre mémoire nous fait défaut. Presque une éternité pour les générations les plus jeunes. Soixante-sept ans, l'âge de nos parents ou grands-parents qui, enfants ce jour-là, vous ont aperçus ou entendus avec vos drôles d'accent, mi-confiants, mi-méfiants. Ils ne savaient pas encore qui vous étiez, ni d'où vous veniez exactement. Parce qu'ils n'avaient connu que la peur, la guerre, les privations diverses.
"Alors que nous avançons vers la terre, dans la pâleur grise de l'aube, l'embarcation de fer ressemble à un cercueil de 12 mètres, prenant des paquets d'eau verte qui retombent sur les têtes casquées des hommes serrés épaule contre épaule, dans l'inconfortable, l'insupportable, la dure solitude des soldats allant au combat » (Ernest Hemingway – 6 juin 1944). Il y a si longtemps déjà, que – parfois - notre mémoire nous fait défaut. Presque une éternité pour les générations les plus jeunes. Soixante-sept ans, l'âge de nos parents ou grands-parents qui, enfants ce jour-là, vous ont aperçus ou entendus avec vos drôles d'accent, mi-confiants, mi-méfiants. Ils ne savaient pas encore qui vous étiez, ni d'où vous veniez exactement. Parce qu'ils n'avaient connu que la peur, la guerre, les privations diverses.
Cependant, votre histoire demeure intacte. Elle n'a pas pris une ride. Elle restera éternelle, quoi qu'il arrive. Perfide aussi, l'histoire, qui vous a pris bien plus : votre jeunesse, vos espoirs, vos idéaux, vos illusions, vos rêves d'avenir. En une nuit et un jour, elle a fait de vous - presque encore adolescents, à peine sortis des jupes de vos chères mères - des adultes. Elle vous a envoyés par-delà la vie, le quotidien, le commun et la banalité. Vous avez été catapultés dans la grande histoire ; de celle dont la mémoire s'empare pour ne plus la lâcher, pour la perpétuer au long des générations, de plus en plus lointaines. Par votre désintéressement et votre humilité, l'histoire a fait de chacun de vous des héros.
En traversant les mers et les océans, les continents parfois, vous nous avez offert le plus beau des cadeaux. Par vos frayeurs dissimulées, vos plaintes silencieuses, vos sanglots retenus, vous nous avez rendu notre fierté : le droit de vivre en hommes et femmes libres. Bien sûr, avant d'arriver à ce jour tant attendu, tant espéré, tant rêvé pour des millions d'Européens, il y avait eu des précédents. A commencer par le débarquement de Dieppe en août 1942, ou de l'opération Tigre, ultime répétition du débarquement, en avril 1944. Et à chaque fois, les mêmes mots qui vous reviennent en bouche, comme une éternelle prière destinée à un hypothétique Dieu sensé vous préserver du pire. Ainsi, Robert Boulanger - jeune soldat québécois - qui envoie une lettre à ses parents, leur demandant pardon pour toute la peine et l'angoisse causées par le passé. "J'en profite pour vous demander pardon pour toute la peine que j'ai pu vous causer, sur lors de mon enrôlement. Si je reviens vivant de cette aventure, et si je reviens à la maison, à la fin de la guerre, je ferai tout ce que je pourrai pour sécher tes larmes, maman, je ferai tout en mon pouvoir afin de vous faire oublier toutes les angoisses dont je suis la cause". Robert Boulanger ne reviendra jamais à la maison, laissant ses parents, ses frères et sœurs désemparés, confondus dans la peine et la tristesse. Il repose en paix au cimetière canadien de Dieppe, avec ses camarades. Il était le plus jeune des combattants et venait de fêter ses 18 ans.
Puis vint le jour J. Destination la terre de France. Les plages normandes, avec leurs drôles de nom de code : Sword, Juno, Gold, Omaha, Utah. Que savaient-ils de la France ces GI's, ces tommies, ces canadiens - lointains cousins acadiens ? Sans parler de tous les autres, origines et croyances confondues, associées dans une même communion de pensée : Norvégiens, Hollandais, Belges, Polonais, Tchèques, Australiens, Grecs, quelques Allemands même refusant l'inique, tant d'autres encore ... Et les français. Ceux qui avaient décidé de se battre autrement. "Pour eux, la France n'est pas un drapeau, mais une maison, une lande, une mère, une fiancée ou la barque dans un monde en paix".

Bien sûr, il y a l'angoisse, la peur au ventre, celle qui vous pousse à vomir, qui vous empêche de dormir, de penser à autre chose qu'à la mort, aux siens une dernière fois. Vous vous êtes rattachés à l'espoir de la prière ; vous n'avez jamais autant prié que cette nuit-là. Un dernier Pater, un dernier Ave, avant le grand saut dans l'inconnu, le brouillard, la folie meurtrière. Robert Capa l'a décrit avec justesse avant le débarquement sur Omaha : "Attendant la première lueur du jour, les deux mille hommes se tiennent debout dans un silence total ; et quelle que soient leurs pensées, ce silence ressemble à une prière". Mais il n'est pas seul à vivre cette attente, pire que tout. Alfred Birra, capitaine qui débarquera à Utah Beach l'écrira à sa femme. "Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui dorment en cette nuit du 5 juin ... la plupart d'entre nous sommes assis, occupés à parler, à jouer aux cartes, à boire du café et à faire le genre de choses que font les hommes quand ils sont anxieux, un peu effrayés, et qu'ils ne veulent pas le montrer [...]. Comment décrire le sentiment d'angoisse qui vous étreint dans ce genre de situation". Rien que ces deux témoignages nous donnent une idée de la tension qui existait en chacun d'eux.
Et d'un coup, tout explose, tout se rompt, tout saute, tout vole en éclats, tout part en morceaux : les hommes, le matériel, les barges, les âmes, la panique des premiers instants, les angoisses. Tout se mélange, les corps et le sable, le sang, la terre et l'eau. Pour ceux qui ont posé les pieds sur les plages de France cette aube-là, c'est une sensation de fin du monde. Omaha - bloody Omaha - devient un enfer pour ces soldats innocents, jetés par vague dans la nasse. Tous ceux qui ont débarqué sur ce bout de plage ne pourront jamais oublier cette irréalité, ce cauchemar vivant et permanent. William Marshall, futur ingénieur de 19 ans, la décrira comme la pire de toutes les plages. "La boucherie d'Easy Red est pire que tout. Des cadavres, que la mer a rejetés au bord des dunes, [...] abandonnés sans dignité [...]. Ils représentent tous les échelons de service, depuis le simple soldat jusqu'au grade le plus élevé ; ils illustrent l'adage suivant lequel, dans la mort, tous sont égaux. La mort ne fait pas de discrimination, c'est le plus grand niveleur qui soit".
Ce qui peut être paradoxal, c'est que - malgré toute l'horreur et la confusion - la vie reprend toujours le dessus. Plus forte que toutes les dévastations, les anéantissements, certains trouvent le courage, la force de voir le bon côté des événements. Edward Rhodes Hargreaves, des services médicaux anglais, compare le verger dans lequel il se trouve pour la nuit à ceux du Kent. Il trouve le temps de décrire le paysage - presque de carte postale - dans lequel il évolue. "La campagne avoisinante est parsemée de petits villages. Dans chacun d'eux, il n'est pas rare de trouver une ou deux maisons de campagne adorables". Un instant de rêve, dans un monde de haine, de douleurs et de violence. Il ne sera pas le seul à voir l'aspect insolite de ces journées tout à la fois épiques, picaresques et barbares. Jean-Paul Gagnon, soldat canadien, cantonné à Banville apercevra une hirondelle qui lui rappellera son Canada. L'hirondelle, oiseau porte bonheur ! D'autres verront des fleurs sur le bord des routes, parmi les traces d'obus, les maisons détruites. Tout pour retrouver une vie normale, dans un monde chamboulé, tourneboulé, chambardé, désorganisé, désordonné, transformé.
Évidemment, ceux qui tirent leur épingle du jeu, ce sont les enfants. Ils courent après ce qui porte un uniforme allié, en quête de chocolat, de bonbons, chewing gums, cigarettes et autres friandises. Tout le monde sympathise, malgré les destructions. C'est la Libération. La vraie, la seule et unique. Chacun sait que l'autre apporte la Paix dans ses bagages. Cela rapproche et créé des liens, indissolubles. Mais elle aura un coût, cette Paix. Nous le savons tous, par l'histoire racontée dans nos familles, par nos parents, nos grands-parents. Nous savons ce nous leur devons : tout ou presque. La liberté de penser sans risque ; la démocratie retrouvée ; la paix depuis plus de soixante ans. Et surtout, la réconciliation avec les Allemands. Plus de soixante ans que les gens visitent les plages, les cimetières, les lieux des batailles, pour toujours se rappeler qu'un jour - enfin - ils sont venus. "Il est très touchant de voir la façon dont ils prennent soin des tombes de nos soldats [...]. Sur chaque tombe, un vase de fleurs fraîches placé là par un civil ..." (Edward Rhodes Hargreaves - 25 juillet 1944). Il en est ainsi depuis soixante-sept ans !
apporte la Paix dans ses bagages. Cela rapproche et créé des liens, indissolubles. Mais elle aura un coût, cette Paix. Nous le savons tous, par l'histoire racontée dans nos familles, par nos parents, nos grands-parents. Nous savons ce nous leur devons : tout ou presque. La liberté de penser sans risque ; la démocratie retrouvée ; la paix depuis plus de soixante ans. Et surtout, la réconciliation avec les Allemands. Plus de soixante ans que les gens visitent les plages, les cimetières, les lieux des batailles, pour toujours se rappeler qu'un jour - enfin - ils sont venus. "Il est très touchant de voir la façon dont ils prennent soin des tombes de nos soldats [...]. Sur chaque tombe, un vase de fleurs fraîches placé là par un civil ..." (Edward Rhodes Hargreaves - 25 juillet 1944). Il en est ainsi depuis soixante-sept ans !
Il arrive parfois que les blogs suscitent des rencontres qui ne doivent rien au hasard. De toute façon, je ne crois pas au hasard. Je lui préfère - de loin - la destinée. Après une première publication de ce billet sur mon précédent blog, j'ai reçu un mail. L'expéditeur de ce message se prénommait - Denise - et l'objet en était pour le moins sibyllin. J'avoue avoir failli le supprimer sans même l'ouvrir. Ma curiosité naturelle m'a conseillée d'y jeter un coup d'œil. Après hésitation, j'ai ouvert ce message quelque peu étrange. Quelle surprise ai-je eu en lisant ce message ! Celui-ci contenait deux photos qui concernaient un jeune soldat québécois - Robert Boulanger - tué lors du Débarquement de Dieppe en août 1942. Il était le plus jeune soldat et venait de fêter ses 18 ans. Je me suis alors souvenue en avoir parlé dans le billet consacré à cet ouvrage. Je dois reconnaître que l'envoi de ces deux photos - suivies d'autres plus tard - m'a profondément touchée, émue.
Le message expliquait qui était Denise - sa nièce - et pourquoi elle m'envoyait ces photos si personnelles. Elle était arrivée sur mon blog en cherchant des informations sur l'oncle qu'elle n'a jamais connu et avait lu cet article qu'elle avait apprécié. En remerciement de cet humble hommage, elle m'envoyait des photos de celui-ci. Il arrive souvent que l'on écrive des billets sur des livres qui nous marquent pour des raisons strictement personnelles. Tel était le cas pour cet article. Il arrive aussi que des personnes y reconnaissent un des leurs. Cela a été le cas pour Denise. Je la remercie infiniment pour son message et ses envois que je conserve précieusement. Depuis ce jour, je corresponds régulièrement avec Denise.
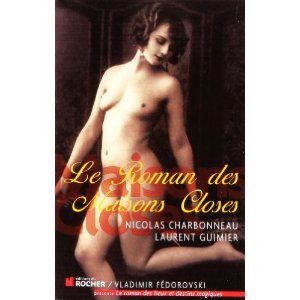 "J’ai veillé pendant toutes ces années sur un monde étrange. Sans le juger. Un univers que beaucoup, sans toujours le connaître, ont encensé ou méprisé. Interdit ou toléré. J’ai veillé sur des femmes et des hommes. Des brigands, des jeunes filles égarées, des maîtresses de maison au caractère bien trempé, des rabatteurs, des femmes légères et d’autres éternellement tristes, des clients salaces, des coquins, des gentils garçons ou de vrais pervers. Je n’ai jamais rien dit. Muette pour l’éternité. Jusqu’à ce jour où j’ai décidé de me confier. Oh, je ne vous dirai pas tout. Il y a des secrets qui partiront avec moi. Mais je veux être celle qui vous éclairera une dernière fois sur ce qui se passait derrière le velours des rideaux qu’il fallait écarter pour entrer dans ces maisons fermées. Des maisons closes. Qui portaient si bien leur nom ».
"J’ai veillé pendant toutes ces années sur un monde étrange. Sans le juger. Un univers que beaucoup, sans toujours le connaître, ont encensé ou méprisé. Interdit ou toléré. J’ai veillé sur des femmes et des hommes. Des brigands, des jeunes filles égarées, des maîtresses de maison au caractère bien trempé, des rabatteurs, des femmes légères et d’autres éternellement tristes, des clients salaces, des coquins, des gentils garçons ou de vrais pervers. Je n’ai jamais rien dit. Muette pour l’éternité. Jusqu’à ce jour où j’ai décidé de me confier. Oh, je ne vous dirai pas tout. Il y a des secrets qui partiront avec moi. Mais je veux être celle qui vous éclairera une dernière fois sur ce qui se passait derrière le velours des rideaux qu’il fallait écarter pour entrer dans ces maisons fermées. Des maisons closes. Qui portaient si bien leur nom ».

 238 - 1 = 237 livres dans ma PAL ...
238 - 1 = 237 livres dans ma PAL ...