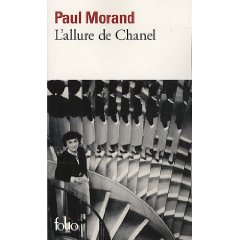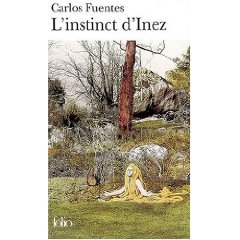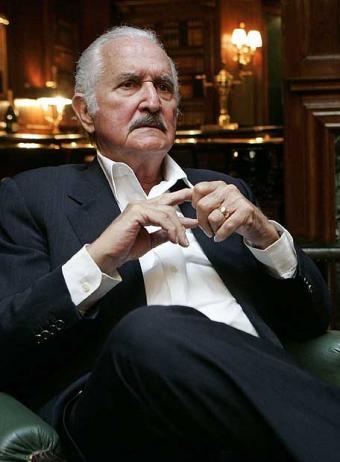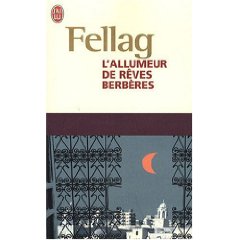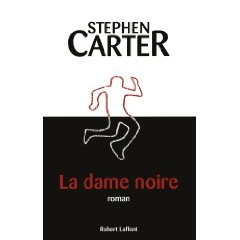 Lemaster et Julia Carlyle font partie des rares couples africains-américains dans le bastion de la blanchitude de Tyler's Landing, dans le Comté d'Harbor. Ces deux-là ont un train de vie huppé et bourgeois, fréquentant assidument le milieu du pouvoir politique à la Maison Blanche. Ancien conseiller du président des États-Unis, Lemaster Carlyle est devenu le président noir de la prestigieuse université de New England. Alors qu'ils rentrent d'une réception à l'université, ils sont pris dans une tempête de neige. Leur voiture fait une embardée et quitte la route. Une route de campagne, perdue au milieu de nulle part et qu'ils n'auraient jamais dû prendre. Il est parfois des erreurs commises qui bouleversent l'existence de personnes socialement bien installées. Parce que à cause de cet accident stupide sur cette vulgaire piste forestière, les Carlyle ont trouvé un corps, celui de Kellen Zant, chercheur brillant, titulaire d'une chaire en économie dans l'université où Lemaster Carlyle est président. Entre eux deux, une sourde rivalité existait, dont les journaux s'étaient fait l'écho. Deux afro-américains brillants dans leur domaine, l'un venant de la upper class américaine, l'autre descendant d'anciens esclaves noirs du sud des États-Unis, la presse blanche en faisait régulièrement ses choux gras. Surtout, Julia Carlyle avait été la maîtresse de Kellen Zant avant son mariage avec Lemaster. "Le professeur Zant était l'inventeur d'une formule particulière en économie, n'est-ce-pas ? Une sorte de théorème ? Une méthode pour mieux estimer les valeurs boursières passées en fonction d'événements hypothétiques, a répondu le président, cherchant une nouvelle fois à tester l'intellect des deux limiers. Ils ont attendu la suite. C'était encore à ses débuts, quand j'étais jeune diplômé, a poursuivi Lemaster. L'équation Zant-Feldman, l'une des avancées les plus significatives de la théorie de la finance au cours de ces cinquante dernières années".
Lemaster et Julia Carlyle font partie des rares couples africains-américains dans le bastion de la blanchitude de Tyler's Landing, dans le Comté d'Harbor. Ces deux-là ont un train de vie huppé et bourgeois, fréquentant assidument le milieu du pouvoir politique à la Maison Blanche. Ancien conseiller du président des États-Unis, Lemaster Carlyle est devenu le président noir de la prestigieuse université de New England. Alors qu'ils rentrent d'une réception à l'université, ils sont pris dans une tempête de neige. Leur voiture fait une embardée et quitte la route. Une route de campagne, perdue au milieu de nulle part et qu'ils n'auraient jamais dû prendre. Il est parfois des erreurs commises qui bouleversent l'existence de personnes socialement bien installées. Parce que à cause de cet accident stupide sur cette vulgaire piste forestière, les Carlyle ont trouvé un corps, celui de Kellen Zant, chercheur brillant, titulaire d'une chaire en économie dans l'université où Lemaster Carlyle est président. Entre eux deux, une sourde rivalité existait, dont les journaux s'étaient fait l'écho. Deux afro-américains brillants dans leur domaine, l'un venant de la upper class américaine, l'autre descendant d'anciens esclaves noirs du sud des États-Unis, la presse blanche en faisait régulièrement ses choux gras. Surtout, Julia Carlyle avait été la maîtresse de Kellen Zant avant son mariage avec Lemaster. "Le professeur Zant était l'inventeur d'une formule particulière en économie, n'est-ce-pas ? Une sorte de théorème ? Une méthode pour mieux estimer les valeurs boursières passées en fonction d'événements hypothétiques, a répondu le président, cherchant une nouvelle fois à tester l'intellect des deux limiers. Ils ont attendu la suite. C'était encore à ses débuts, quand j'étais jeune diplômé, a poursuivi Lemaster. L'équation Zant-Feldman, l'une des avancées les plus significatives de la théorie de la finance au cours de ces cinquante dernières années".Le jour de l'enterrement, Julia est accostée par une amie intime de Kellen Zant - Mrs Mary Malard -, journaliste, qui lui tient un discours incohérent concernant des éléments d'un soi-disant surplus. Rien qui ne tienne réellement la route et puisse faire démarrer l'enquête sur son assassinat. Julia apprend ensuite qu'un cambriolage a eu lieu chez l'oncle de Kellen. Tout ce qui concernait le dossier sur lequel celui-ci travaillait a été volé. Rien d'important selon cet oncle. Sauf que des événements curieux surviennent depuis le meurtre et cette curieuse rencontre au cimetière. Un avocat véreux - Tony Tice - a cherché à contacter Julia Carlyle. Il s'est intéressé de très près à son travail de vice-présidente de l'école de théologie, aux recherches de sa fille Vanessa, à ses relations avec Kellen Zant. Il a même voulu pénétrer dans son bureau. Sans succès. La curiosité a ses limites.
Julia apprendra petit à petit que Kellen Zant était sur la piste d'une affaire
 importante, une histoire ancienne qui avait - en son temps - perturbée la vie calme et tranquille de Tyler's Landing. Un meurtre avait été commis, trente ans auparavant. La victime - Gina Joule - appartenait à la upper class blanche du Landing, son père étant à l'époque le président de l'université du comté. Cela avait secoué ce coin sans problèmes, et ravivé les vieilles phobies et autres aversions contre la communauté noire de la région. Un jeune noir américain - DeShaun Moton - avait été tué quelques jours après par la police, lors d'un vol de voiture. Il était le coupable idéal pour calmer l'atmosphère sulfureuse du moment. Surtout qu'un témoin l'avait vu discuter avec Gina Joule le soir de son meurtre. Seulement, certains habitants étaient convaincus que l'enquête avait été bâclée pour protéger le vrai coupable. Si cela était le cas, les retombées allaient être fracassantes et risquaient d'éclabousser de hautes figures politiques. Kellen Zant voulait monnayer un article compromettant sur cet étrange affaire à un client de Tony Tice. "Le professeur Zant était en possession d'un article dont mon client était prêt à se rendre acquéreur. Ils étaient parvenus à un marché. Zant lui a donné un aperçu, un "amuse-gueule", comme il disait, en promettant de lui remettre l'article lui-même d'ici une quinzaine. Et puis quelqu'un l'a abattu. - Vous avez terminé ? - Shari Larid, a-t-il prononcé à brûle-pourpoint. - Quoi ? - C'est le nom de quelqu'un. Shari Larid. - Il l'a épelé. - Une professeur remplaçante. zant a dit que vous sauriez comment la joindre. Julia a secoué la tête".
importante, une histoire ancienne qui avait - en son temps - perturbée la vie calme et tranquille de Tyler's Landing. Un meurtre avait été commis, trente ans auparavant. La victime - Gina Joule - appartenait à la upper class blanche du Landing, son père étant à l'époque le président de l'université du comté. Cela avait secoué ce coin sans problèmes, et ravivé les vieilles phobies et autres aversions contre la communauté noire de la région. Un jeune noir américain - DeShaun Moton - avait été tué quelques jours après par la police, lors d'un vol de voiture. Il était le coupable idéal pour calmer l'atmosphère sulfureuse du moment. Surtout qu'un témoin l'avait vu discuter avec Gina Joule le soir de son meurtre. Seulement, certains habitants étaient convaincus que l'enquête avait été bâclée pour protéger le vrai coupable. Si cela était le cas, les retombées allaient être fracassantes et risquaient d'éclabousser de hautes figures politiques. Kellen Zant voulait monnayer un article compromettant sur cet étrange affaire à un client de Tony Tice. "Le professeur Zant était en possession d'un article dont mon client était prêt à se rendre acquéreur. Ils étaient parvenus à un marché. Zant lui a donné un aperçu, un "amuse-gueule", comme il disait, en promettant de lui remettre l'article lui-même d'ici une quinzaine. Et puis quelqu'un l'a abattu. - Vous avez terminé ? - Shari Larid, a-t-il prononcé à brûle-pourpoint. - Quoi ? - C'est le nom de quelqu'un. Shari Larid. - Il l'a épelé. - Une professeur remplaçante. zant a dit que vous sauriez comment la joindre. Julia a secoué la tête".Il devient rapidement évident que pour la bonne image de cette célèbre université privée, et prisée par l'ensemble de la bonne société américaine, l'enquête sur le meurtre de Kellen Zant doit être menée discrètement, tout en ménageant les susceptibilités sociales et raciales. L'important est d'éviter tout scandale pouvant salir des personnes hauts placées, politiquement et économiquement influentes. Certaines d'entre elles interviendront pour mettre un point final aux investigations de la police. C'est sans compter sur la pugnacité de Julia Carlyle et de Bruce Vallely, le responsable de la sécurité du campus. Et si cet assassinat - presque banal - masquait quelque chose de bien plus profond, de bien plus enfoui. Et si cela cachait tout simplement la vérité sur l'affaire Gina Joule.
Stephen Carter est un auteur brillant et un brin poil à gratter dans le milieu afro-américain. Après plusieurs essais socio-politiques dérangeant, l'auteur se consacre à l'écriture de romans tout aussi décapants. Avec "La dame noire", Stephen Carter a décidé de s'installer dans la classe sociale aisée noire américaine. C'est l'occasion pour lui de poser un certain regard sur cette partie de la société américaine, et sur l'influence de celle-ci. Ici, pas de ghetto noir, miséreux et misérable, violent, où règne l'exclusion, le désespoir, où sue la haine de l'autre, où domine les bandes armées et les trafiquants en tous genres. Rien de tout cela. Au contraire. Un monde feutré, libéral, conformiste et tout aussi fermé. Car, ne nous méprenons surtout pas là-dessus. Dans la upper class africaine-américaine, on trouve aussi des castes, des clans dans lesquels il est très difficile - voire impossible - de se faire accepter. A travers les Carlyle, cette famille parfaitement intégrée dans la société, Stephen Carter nous ouvre les portes d'une micro-société où les personnes bien nées se fréquentent entre elles, vivent dans le même quartier, vont dans les mêmes universités, les mêmes magasins, son invités aux mêmes soirée. Julia et Lemaster Carlyle appartiennent, tous les deux, à des clubs très fermés. Cependant, mêmes bourgeois, cultivés, aisés, les Carlyles restent aux yeux de leurs semblables blancs, des noirs. De fait, certains lieux de Tyler's Landing leur sont interdits. Dans "La dame noire", ce sont deux milieux influents - noirs et blancs - qui s'opposent et s'affrontent parfois, qui ne se connaissent pas ou mal et vivent en parallèle. On a l'impression d'évoluer entre deux mondes qui ne se côtoient que par intérêt personnel réciproque.
Le sujet est traité comme un puzzle. Les
 éléments disparates se mettent en place par touches successives, pour distiller l'intrigue construite par strate. On part d'un crime apparemment crapuleux pour finir avec une affaire qui touche au pouvoir suprême, à la présidence des États-Unis. Dans un style riche, dense, fourni et fourmillant de détails, parfois jusqu'à l'overdose, profond, où la classe noire américaine riche est passée au microscope, Stephen Carter nous entraîne dans un thriller fracassant, haletant, où l'on ressort exsangue. Autant vous prévenir, si vous commencez "La dame noire", elle ne vous quittera pas, vous habitera, vous obsédera jusqu'au bout, et même après.
éléments disparates se mettent en place par touches successives, pour distiller l'intrigue construite par strate. On part d'un crime apparemment crapuleux pour finir avec une affaire qui touche au pouvoir suprême, à la présidence des États-Unis. Dans un style riche, dense, fourni et fourmillant de détails, parfois jusqu'à l'overdose, profond, où la classe noire américaine riche est passée au microscope, Stephen Carter nous entraîne dans un thriller fracassant, haletant, où l'on ressort exsangue. Autant vous prévenir, si vous commencez "La dame noire", elle ne vous quittera pas, vous habitera, vous obsédera jusqu'au bout, et même après.Un grand merci au Blog-o-Book et aux éditions Robert Laffont qui m'ont proposé cette excellente lecture. D'autres avis sur Blog-o-Book.