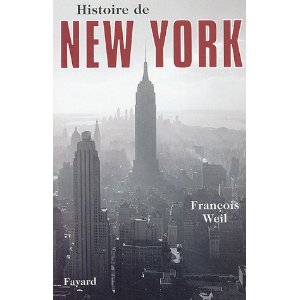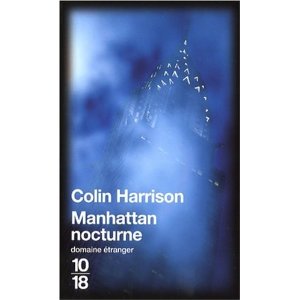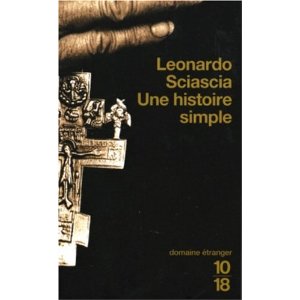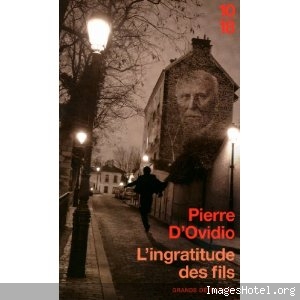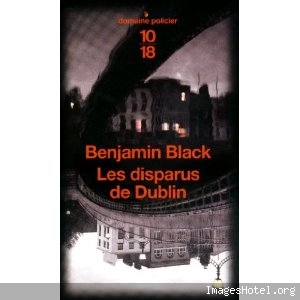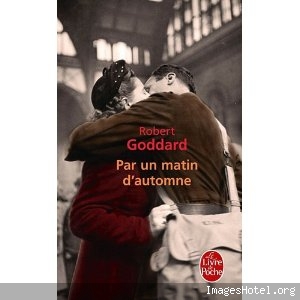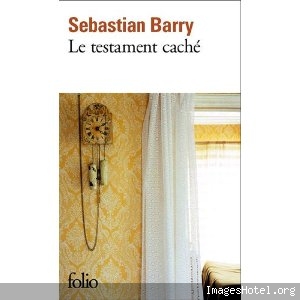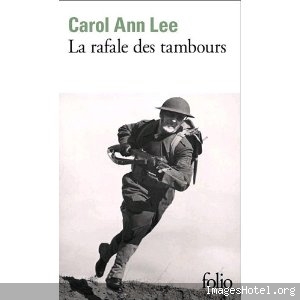Surtout, ne m'en veuillez pas trop si j'ai un peu de retard. Je récupère un peu …
L'ingratitude des fils – Pierre D'Ovidio
Hiver 1945. Paris est libéré mais les conditions matérielles d'existence ne se sont guère améliorées : privations et rationnement, marché noir et trafics en tous genres. C'est dans ce climat de tensions 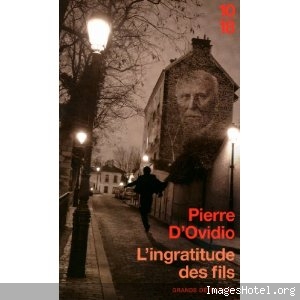 que des enfants, jouant dans les ruines d'un immeuble de Malakoff bombardé, découvrent un cadavre dont une main est peinte en noir. Le jeune inspecteur Maurice Clavault est dépêché pour mener l'enquête. Son unique indice : un message laissé dans la bouche du mort : « A PARM ». Grâce à l'aide de Ginette, sa petite amie actrice, ses pas le mènent jusqu'à un immigré lituanien, sauvé de la rafle du Vel' d'Hiv', un certain Samuel Litvach… Si la victime ne peut plus parler, les fantômes qu'elle a laissés derrière elle parleront à sa place.
que des enfants, jouant dans les ruines d'un immeuble de Malakoff bombardé, découvrent un cadavre dont une main est peinte en noir. Le jeune inspecteur Maurice Clavault est dépêché pour mener l'enquête. Son unique indice : un message laissé dans la bouche du mort : « A PARM ». Grâce à l'aide de Ginette, sa petite amie actrice, ses pas le mènent jusqu'à un immigré lituanien, sauvé de la rafle du Vel' d'Hiv', un certain Samuel Litvach… Si la victime ne peut plus parler, les fantômes qu'elle a laissés derrière elle parleront à sa place.
Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates – Mary Shaffer
Janvier 1946. Londres se relève douloureusement des drames de la Seconde Guerre mondiale et Juliet, jeune écrivaine anglaise, est à la recherche du sujet de son prochain roman. Comment pourrait-elle imaginer que la lettre d'un inconnu, un natif de l'île de Guernesey, va le lui fournir ? Au fil de ses échanges avec son nouveau correspondant, Juliet pénètre son monde et celui de ses amis ? Un monde insoupçonné, délicieusement excentrique. Celui d'un club de lecture créé pendant la guerre pour échapper aux foudres d'une patrouille allemande un soir où, bravant le couvre-feu, ses membres venaient de déguster un cochon grillé (et une tourte aux épluchures de patates...). Juliet est conquise. Peu à peu, elle élargit sa correspondance avec plusieurs membres du Cercle. Jusqu'au jour où elle comprend qu'elle tient avec le Cercle le sujet de son prochain roman et se rend à Guernesey. Ce qu'elle va trouver là-bas changera sa vie à jamais.
Le nid du serpent – Pedro Juan Gutiérrez
Dans le Cuba délabré des années soixante, coincé entre désir de liberté et volontarisme castriste, un jeune garçon fait l'apprentissage de la vie. Le sexe, la violence, mais aussi la soif de culture et le désir d'écrire vont constituer le matériau d'une œuvre à venir, unique et fulgurante. Celle de Pedro Juan Gutiérrez, un des plus grands écrivains cubains contemporains. Sans compromis, avec le brutal
égoïsme de tout écrivain, mais aussi une grande lucidité quant aux avantages d'avoir eu un papa glacier et petit-bourgeois, l'auteur trace ainsi, l'air de rien, la saga de l'entrée de Cuba dans la modernité.
Les disparus de Dublin – Benjamin Black
Dans le Dublin des années 1950, Quirke, médecin légiste consciencieux, noie son passé et ses démons dans le whisky. Un soir d'ivresse, repassant à la morgue, il trouve à son bureau son beau-frère Mal et le cadavre d'une jeune femme tout 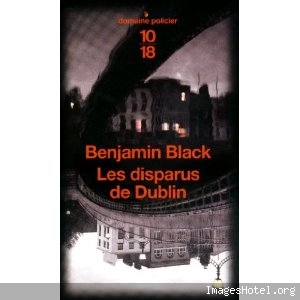 récemment déposé. Quirke a de quoi s'interroger : Mal qui ne s'aventure jamais dans les profondeurs du lieu semble surpris et tente à la hâte de dissimuler un dossier... Des circonstances suffisamment troublantes pour décider Quirke à sortir de l'ombre et se lancer dans une enquête qui menace de dynamiter la haute société catholique, de Dublin à Boston. Et de gangrener l'âme de sa propre famille, en réveillant ses blessures les plus enfouies.
récemment déposé. Quirke a de quoi s'interroger : Mal qui ne s'aventure jamais dans les profondeurs du lieu semble surpris et tente à la hâte de dissimuler un dossier... Des circonstances suffisamment troublantes pour décider Quirke à sortir de l'ombre et se lancer dans une enquête qui menace de dynamiter la haute société catholique, de Dublin à Boston. Et de gangrener l'âme de sa propre famille, en réveillant ses blessures les plus enfouies.
Le cœur est un noyau candide – Lydia Millet
16 juillet 1945 : la première bombe atomique est testée à Los Alamos, au Nouveau Mexique. Au moment précis de l'explosion Robert Oppenheimer, Leo Szilard, et Enrico Fermi, trois des principaux scientifiques responsables du projet, sont mystérieusement transportés en 2006, à Santa Fe. Recueillis par Ann, une bibliothécaire, et son mari Ben, les trois savants déboussolés vont devoir s'adapter tant bien que mal à leur nouvelle vie, à ce monde que leurs actes ont radicalement changé. Après avoir appris l'horreur engendrée par leur création (Hiroshima.. .), et les funestes conséquences de celle-ci, ils ne tarderont pas à entreprendre, des États-Unis au Japon, une croisade pacifiste visant au désarmement total. Entre l'armée et les scientifiques qui voient leur apparition d'un mauvais œil, les groupes religieux qui assimilent leur présence à une prophétie biblique, et une société médiatique qu'il faut apprendre à manipuler, nos trois larrons vont avoir fort à faire.
Bons baisers de Cora Sledge – Leslie Larson
Cora n'est pas prête. Pas prête pour la maison de retraite. Pas prête pour s'endormir mollement en attendant le lendemain. Alors, quand ces enfants décident de la mettre à l'hospice, la vieille dame de 82 ans au tempérament de feu, ne va pas s'en  laisser compter. Obèse, elle fume comme un pompier et se bourre d'antidépresseurs de toutes sortes. Les premiers jours sont pour le moins difficiles. Mais peu à peu, Cora commence à émerger et se lie aux autres pensionnaires, qu'elle ne porte pas vraiment dans son cœur... Excepté Vitus, un homme élégant, d'origine polonaise, au charme dévastateur. Tout en décrivant sa vie présente dans un carnet, Cora raconte son douloureux passé : la vie à la ferme, la disparition d'une sœur et sa liaison avec Édouard puis sa fuite, la mort prématurée de sa fille. Car la vie de Cora est aussi pleine de souvenirs douloureux que de joies à venir… Elle tombe amoureuse de Vitus, et annonce son mariage à ses enfants atterrées et sous le choc. Car l'homme n'est pas celui qu'il prétend être…
laisser compter. Obèse, elle fume comme un pompier et se bourre d'antidépresseurs de toutes sortes. Les premiers jours sont pour le moins difficiles. Mais peu à peu, Cora commence à émerger et se lie aux autres pensionnaires, qu'elle ne porte pas vraiment dans son cœur... Excepté Vitus, un homme élégant, d'origine polonaise, au charme dévastateur. Tout en décrivant sa vie présente dans un carnet, Cora raconte son douloureux passé : la vie à la ferme, la disparition d'une sœur et sa liaison avec Édouard puis sa fuite, la mort prématurée de sa fille. Car la vie de Cora est aussi pleine de souvenirs douloureux que de joies à venir… Elle tombe amoureuse de Vitus, et annonce son mariage à ses enfants atterrées et sous le choc. Car l'homme n'est pas celui qu'il prétend être…
Long week-end – Joyce Maynard
Cette année 1987, une chaleur caniculaire s'abat sur la côte Est pendant le long week-end de Labor Day. Henry a treize ans, vit avec sa mère, ne supporte pas la nouvelle épouse de son père, aimerait s'améliorer au base-ball et commence à être obsédé par les filles. Jusque-là, rien que de très ordinaire, sauf que sa mère, elle, ne l'est pas. Encore jeune et jolie, Adele vit pratiquement retirée du monde et ne sort qu'en de rares circonstances. La rentrée des classes qui approche la contraint à conduire son fils acheter vêtements et fournitures au centre commercial. Et là, planté devant le présentoir des magazines où il essaye de feuilleter Playboy, Henry se heurte à Frank, ou plutôt Frank s'impose à Henry : Frank, un taulard évadé, condamné pour meurtre…
L'énigme du retour – Dany Laferrière
La nouvelle coupe la nuit en deux. L'appel téléphonique fatal que tout homme d'âge mûr reçoit un jour. Mon père vient de mourir. D. L. A la suite de cette annonce tragique, le narrateur décide de retourner dans son pays natal. Il en avait été exilé, comme son père des années avant lui, par le dictateur du moment. Et le voilà qui revient sur les traces de son passé, de ses origines, accompagné d'un neveu qui porte le même nom que lui. Un périple doux et grave, rêveur et plein de charme, qui lui fera voir la misère, la faim, la violence, mais aussi les artistes, les jeunes filles, l'espoir, peut-être. Le grand roman du retour d'exil.
La boucherie des amants – Gaetano Bolan
Dans une petite ville du Chili qui vit les dernières heures du régime de Pinochet, une boucherie de quartier est le théâtre de curieuses rencontres : des réunions secrètes s'y tiennent, des passions s'y nouent... Un enfant aux yeux de nuit, une institutrice révolutionnaire et un boucher fort en gueule composent ainsi le trio majeur de cette fable moderne, teintée d'humour et de poésie. Mais, sous la naïveté apparente du récit, l'auteur condamne sans appel les régimes totalitaires...
La peine du menuisier – Marie Le Gall
La narratrice grandit dans une atmosphère lourde de non-dits, dans une maison écrasée par le silence, dont les murs de pierre suintent le mystère… Son père n'est qu'une ombre solitaire. Pourquoi celui qu'elle appelle le Menuisier est-il si lointain ? Pourquoi sa famille semble-t-elle perpétuellement en deuil ? Elle aimerait poser des questions, mais on est taiseux dans le Finistère. Des années lui seront nécessaires pour percer le secret de son ascendance, mesurer l'invisible fardeau dont elle a hérité. D'une plume à la fois vibrante et pudique, Marie Le Gall décrypte l'échec d'une relation père-fille.
Manhattan Freud – Luc Bossi
En 1909, la notoriété de Freud est déjà immense. Il ne lui reste qu'à conquérir l'Amérique. Mais à New York l'attend le plus grand défi de sa carrière : déchiffrer l'âme d'un mystérieux tueur en série et réussir là où la police a échoué…
Par un matin d'automne – Robert Goddard
Fin des années 1990. Leonora Galloway part en France avec sa fille afin de se rendre à Thiepval, près d'Amiens, au mémorial qui honore les soldats - dont de 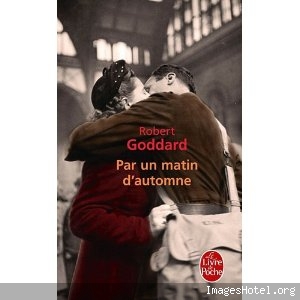 nombreux Britanniques, comme son père - tombés durant la bataille de la Somme, lors de la Grande Guerre. Le 30 avril 1916 est la date officielle de son décès. Or Leonora est née près d'un an plus tard. Ce qui pourrait n'être qu'un banal adultère cache en fait une étrange histoire, des secrets de famille, sur lesquels plane l'ombre d'un meurtre jamais résolu et où chaque mystère en dissimule un autre… Dans ce livre envoûtant, Robert Goddard allie l'atmosphère des plus grands romans anglais à un sens du suspense et de la reconstitution historique remarquables.
nombreux Britanniques, comme son père - tombés durant la bataille de la Somme, lors de la Grande Guerre. Le 30 avril 1916 est la date officielle de son décès. Or Leonora est née près d'un an plus tard. Ce qui pourrait n'être qu'un banal adultère cache en fait une étrange histoire, des secrets de famille, sur lesquels plane l'ombre d'un meurtre jamais résolu et où chaque mystère en dissimule un autre… Dans ce livre envoûtant, Robert Goddard allie l'atmosphère des plus grands romans anglais à un sens du suspense et de la reconstitution historique remarquables.
Un soupçon légitime – Stefan Zweig
Un soupçon légitime raconte l'histoire d'un homme dont les passions vont causer le malheur de son entourage. John Limpley s'installe à la campagne avec son épouse et adopte un chien, Ponto. Adulé par son maître, l'animal se transforme en tyran... jusqu'au jour où il est délaissé, lorsque la jeune femme tombe enceinte. Le drame qui va suivre est d'autant plus tragique qu'il reste inexpliqué. Dans cette nouvelle angoissante, inédite en français, on retrouve le style inimitable de Zweig et sa finesse dans l'analyse psychologique. Comme dans Lettre d'une inconnue ou Le joueur d'échecs, il dépeint avec virtuosité les conséquences funestes de l'obsession et de la démesure des sentiments.
La fortune de Richard Wallace – Lydie Perreau
Qui était véritablement Richard Wallace ? D'où vient la fabuleuse collection londonienne qui porte son nom ? Pour répondre à ces questions, Lydie Perreau s'est livrée à une enquête minutieuse. Enfant abandonné, recueilli par Lady Hertford, Richard Wallace va être étroitement mêlé aux destinées de cette grande famille de l'aristocratie britannique, installée à Paris depuis 1802. A tel point qu'en août 1870, lorsque Lord Hertford meurt dans son château de Bagatelle, un étrange testament fait de Wallace son légataire universel. Wallace serait-il un descendant illégitime des Hertford, ou un usurpateur ayant détourné leur héritage à son profit ? A partir d'archives inédites, l'auteur raconte l'histoire d'une dynastie fascinante.
Le juif Süss – Lion Feuchtwanger
Dans l'Allemagne du XVIIIe siècle, Süss Oppenheimer, financier de génie, doté d'une intelligence et d'une habileté politique hors du commun, cherche un prince à la mesure de son ambition. Sa rencontre avec le futur duc de Würtemberg marque le point de départ d'une fulgurante ascension. À son service, il devient le plus fameux des « Juifs de cour », ces conseillers aussi indispensables aux puissants que détestés du peuple. Il finira pendu, victime expiatoire d'une société en mal de bouc émissaire. Chef-d'œuvre de la littérature allemande, qui connut une renommée internationale dès sa parution en 1925, l'œuvre de Lion Feuchtwanger a été l'objet d'un véritable détournement, lorsque la propagande nazie, sous la houlette de Goebbels, en fit un film ignoble qui devint le symbole même de l'antisémitisme.
Le testament caché – Sebastian Barry
Roseanne McNulty a cent ans ou, du moins, c'est ce qu'elle croit. Elle a passé plus de la moitié de sa vie dans l'institution psychiatrique de Roscommon, où elle écrit en cachette l'histoire de sa jeunesse, lorsqu'elle était encore belle et aimée. 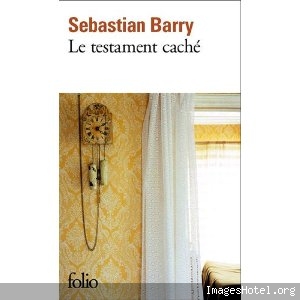 L'hôpital est sur le point d'être détruit, et le docteur Grene, son psychiatre, doit évaluer si Roseanne est apte ou non à réintégrer la société. Pour cela, il devra apprendre à la connaître, et revenir sur les raisons obscures de son internement. Au fil de leurs entretiens, et à travers la lecture de leurs journaux respectifs, le lecteur est plongé au cœur de l'histoire secrète de Roseanne, dont il découvrira les terribles intrications avec celle de l'Irlande. A travers le sort tragique de Roseanne et la figure odieuse d'un prêtre zélé, le père Gaunt, Sebastian Barry livre ici dans un style lumineux un roman mystérieux et entêtant.
L'hôpital est sur le point d'être détruit, et le docteur Grene, son psychiatre, doit évaluer si Roseanne est apte ou non à réintégrer la société. Pour cela, il devra apprendre à la connaître, et revenir sur les raisons obscures de son internement. Au fil de leurs entretiens, et à travers la lecture de leurs journaux respectifs, le lecteur est plongé au cœur de l'histoire secrète de Roseanne, dont il découvrira les terribles intrications avec celle de l'Irlande. A travers le sort tragique de Roseanne et la figure odieuse d'un prêtre zélé, le père Gaunt, Sebastian Barry livre ici dans un style lumineux un roman mystérieux et entêtant.
Le grand Quoi – Dave Eggers
«Valentino n'a pas huit ans lorsqu'il est contraint de fuir Marial Bai, son village natal, traqué par les cavaliers arabes, ces miliciens armés par Khartoum. Comme des dizaines de milliers d'autres gosses, le jeune Soudanais va parcourir à pied des centaines de kilomètres pour échapper au sort des enfants soldats et des esclaves. Valentino passera ensuite plus de dix ans dans des camps de réfugiés en Éthiopie et au Kenya, avant d'obtenir un visa pour l'Amérique. Ironie du sort, son départ était prévu le 11 septembre 2001. Quelques jours plus tard, il s'envolera enfin pour Atlanta. Dans une nouvelle jungle, urbaine cette fois, Valentino l'Africain découvre une face inattendue du racisme. Cette nouvelle existence pourrait bien se révéler aussi périlleuse que la survie dans des contrées ravagées par la guerre. A mi-chemin entre le roman picaresque et le récit d'apprentissage, ce livre est avant tout le fruit d'un échange. Eggers l'Américain a passé des centaines d'heures à écouter Valentino l'Africain se raconter. Au service d'une tradition orale, la plume impertinente de Dave Eggers fait mouche et insuffle à ce récit une dimension épique, qui rappelle celle de Mark Twain». Samuel Todd.
Les taiseux – Jean-Louis Ezine
" Je ne me suis pas toujours appelé du nom que je porte, et c'est comme si j'avais vécu une autre fois. C'est comme si j'avais été un autre. Mais de cet autre, je n'ai aucun souvenir. Rien qui puisse se dire tel, plutôt les ombres floues des réminiscences où s'évanouissent, aux limites de la mémoire, les ultimes rayons d'un monde éteint. J'étais trop jeune pour les souvenirs, quand j'ai cessé d'être lui. Et cependant il a toujours occupé ma pensée, toute ma pensée. Il ne m'arrive rien d'important, ou de misérable, ou de triste ou d'heureux que je n'aie le sentiment étrange de recevoir par délégation. Nous sommes pourtant très différents, lui et moi. Pour commencer, lui avait un père, tandis que moi, je n'ai eu que le manque. Tout, depuis toujours, a gravité autour de ce trou noir. Je me heurte tous les jours au fantôme de celui que je fus quand je portais un autre nom. " Les taiseux raconte, en trois temps, ou plutôt en trois silences, une vie passée à chercher un père qui se dérobera à toute tentative de le saisir. Nourri par un style très sûr et une réflexion profonde et poignante sur le secret et les origines, Les taiseux est sûrement le texte le plus personnel jamais écrit par Jean-Louis Ezine.
Jan Karski – Yannick Haenel
Varsovie, 1942. La Pologne est dévastée par les nazis et les Soviétiques. Jan Karski est un messager de la Résistance polonaise auprès du gouvernement en exil à Londres. Il rencontre deux hommes qui le font entrer clandestinement dans le ghetto, afin qu'il dise aux Alliés ce qu'il a vu, et qu'il les prévienne que les Juifs d'Europe sont en train d'être exterminés. Jan Karski traverse l'Europe en guerre, alerte les Anglais, et rencontre le président Roosevelt en Amérique. Trente-cinq ans plus tard, il raconte sa mission de l'époque dans Shoah, le grand film de Claude Lanzmann. Mais pourquoi les Alliés ont-ils laissé faire l'extermination des Juifs d'Europe ? Ce livre, avec les moyens du documentaire, puis de la fiction, raconte la vie de cet aventurier qui fut aussi un Juste.
Prix Interallié 2009. Prix du Roman Fnac 2009
La rafale des tambours – Carol Ann Lee
Le 11 novembre 1920, le corps du Soldat inconnu est mis en terre à l'abbaye de Westminster à Londres. Parmi ceux qui assistent à la cérémonie, qualifiée par le 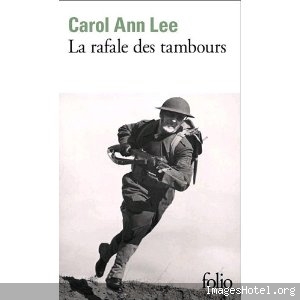 Times de « plus grande effusion de larmes que l'Angleterre ait jamais connue » figure Alex Dyer. S'il a tout fait pour appartenir à la commission chargée de sélectionner celui qui va incarner les millions d'hommes morts sur le front pour leur patrie, c'est qu'il a une dette à payer. La Rafale des tambours retrace l'histoire de trois personnes emprisonnées dans le cauchemar de la Grande Guerre : le journaliste Alex Dyer, son ami d'enfance Ted Eden et Clare, l'infirmière que Ted a épousée lors d'une permission. Alex aime Ted comme son frère, mais Clare lui inspire une passion à laquelle ni lui ni elle ne sauront résister. Ce premier roman est une puissante évocation des ravages que causent la guerre, l'amour et le
Times de « plus grande effusion de larmes que l'Angleterre ait jamais connue » figure Alex Dyer. S'il a tout fait pour appartenir à la commission chargée de sélectionner celui qui va incarner les millions d'hommes morts sur le front pour leur patrie, c'est qu'il a une dette à payer. La Rafale des tambours retrace l'histoire de trois personnes emprisonnées dans le cauchemar de la Grande Guerre : le journaliste Alex Dyer, son ami d'enfance Ted Eden et Clare, l'infirmière que Ted a épousée lors d'une permission. Alex aime Ted comme son frère, mais Clare lui inspire une passion à laquelle ni lui ni elle ne sauront résister. Ce premier roman est une puissante évocation des ravages que causent la guerre, l'amour et le
remords.
Le gendarme scalpé – Thierry Bourcy
Picardie, juillet 1918. Célestin enquête sur un crime étrange : un gendarme a été assassiné puis scalpé. Ses recherches mènent le jeune policier auprès des soldats américains venus soutenir les positions françaises. Il y rencontre un Indien, premier suspect mais dont la culpabilité est incertaine. Célestin découvre que la victime était obsédée par un cambriolage commis en 1910 dans lequel son frère, employé de banque, avait trouvé la mort, et dont le butin en lingots d'or n'a jamais été retrouvé. Mais que faisait le gendarme dans la petite église de Domart où l'on a retrouvé son corps ? L'enquête se révèle délicate, les meurtres se multiplient et la situation se corse d'autant que toutes les unités sont engagées dans la contre-attaque lancée par Foch pour réduire la poche de Montdidier.
 "Deux fois dans sa vie, Yitzhok Gersztenfeld connut le sentiment de dire la vérité. La première fois, elle jaillit de lui, comme une exclamation de son cœur, avec toute son évidence. Et elle eut son efficacité. La seconde fois, il la balbutia. Il fut à part cela un homme silencieux. Parler, pour lui, c'était exagérer ».
"Deux fois dans sa vie, Yitzhok Gersztenfeld connut le sentiment de dire la vérité. La première fois, elle jaillit de lui, comme une exclamation de son cœur, avec toute son évidence. Et elle eut son efficacité. La seconde fois, il la balbutia. Il fut à part cela un homme silencieux. Parler, pour lui, c'était exagérer ». comme Yossel à Berlin. Faire venir Maryem, sa fiancée, à Paris. L'épouser. Créer un foyer. Être Français. Oublier la misère d'avoir été Juif en Pologne. Espérer des jours meilleurs, un avenir pour lui, ses enfants. Croire que le bonheur est à portée de main, que l'on peut l'atteindre. Tout faire pour ne pas le voir partir. S'en souvenir. Toujours. « Le bonheur passe dans la vie, comme une ombre portée. On doit se souvenir longtemps de son passage ».
comme Yossel à Berlin. Faire venir Maryem, sa fiancée, à Paris. L'épouser. Créer un foyer. Être Français. Oublier la misère d'avoir été Juif en Pologne. Espérer des jours meilleurs, un avenir pour lui, ses enfants. Croire que le bonheur est à portée de main, que l'on peut l'atteindre. Tout faire pour ne pas le voir partir. S'en souvenir. Toujours. « Le bonheur passe dans la vie, comme une ombre portée. On doit se souvenir longtemps de son passage ». mémoire de ces Juifs français et étrangers, insérés, venus chercher protection et reconnaissance en France, et qui seront trahis, donnés à l'ennemi comme gage de bonnes relations et de collaboration.
mémoire de ces Juifs français et étrangers, insérés, venus chercher protection et reconnaissance en France, et qui seront trahis, donnés à l'ennemi comme gage de bonnes relations et de collaboration.