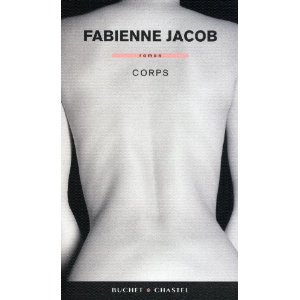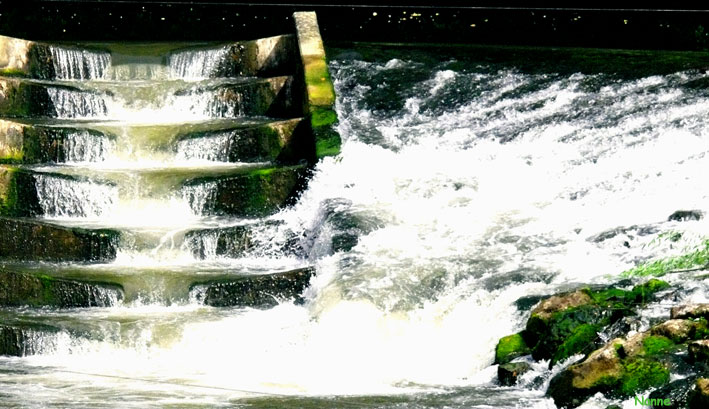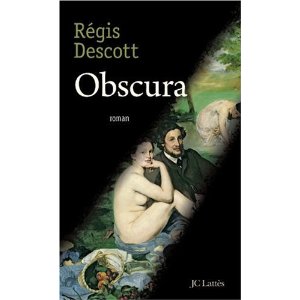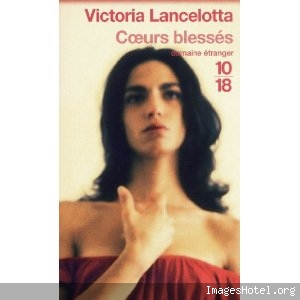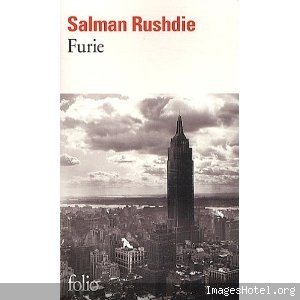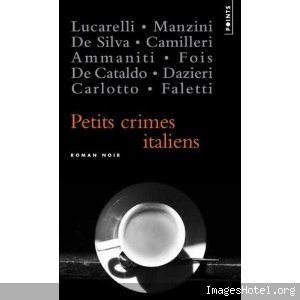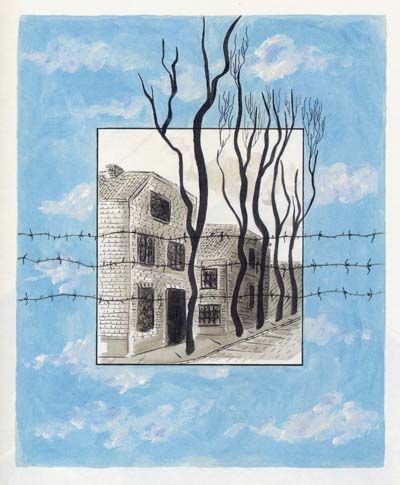Plus prosaïquement, voici quelques petites sorties qui pourraient servir – à l'occasion – d'idée de cadeau de Noël pour ceux qui, comme moi, ne savent jamais ce qu'ils vont offrir le soir même du 24 décembre !
Cœurs blessés – Victoria Lancelotta
Sensible, tranquille, fidèle, généreuse : les qualités que l'on prête généralement à Gina ne sont qu'apparence... Le cœur de la jeune femme est sec et son esprit tourmenté. Elle croit offrir et ne donne - l'homme parfait, en somme. Abandonnée, Gina renoue avec la solitude qui a tout à 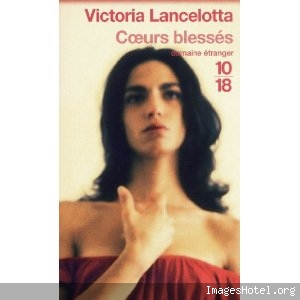 la fois cimenté et miné son enfance, marquée par l'absence de sa mère, partie sans se retourner, et le mutisme de son père. Interrogeant ses errements présents à la lumière du passé, elle entreprend de se dépouiller de ses illusions et de ses mensonges. Au cours de cette mise à nu sans concession, elle découvrira qu'elle a aimé et qu'elle aime encore Daniel... Avec une vertigineuse subtilité, Victoria Lancelotta ausculte le moindre battement de cœur, le moindre regard, le moindre silence. Face à ce roman troublant, on comprend que la critique, des deux côtés de l'Atlantique, n'ait pas hésité à la comparer à Raymond Carver.
la fois cimenté et miné son enfance, marquée par l'absence de sa mère, partie sans se retourner, et le mutisme de son père. Interrogeant ses errements présents à la lumière du passé, elle entreprend de se dépouiller de ses illusions et de ses mensonges. Au cours de cette mise à nu sans concession, elle découvrira qu'elle a aimé et qu'elle aime encore Daniel... Avec une vertigineuse subtilité, Victoria Lancelotta ausculte le moindre battement de cœur, le moindre regard, le moindre silence. Face à ce roman troublant, on comprend que la critique, des deux côtés de l'Atlantique, n'ait pas hésité à la comparer à Raymond Carver.
L'épaisseur des âmes – Colm Tóibín
En exhumant de vieux 33-tours, un fils oblige sa mère à se remémorer un passé qu'elle préfère oublier ; dans un pub irlandais, un fils revoit sa mère qui l a abandonné dix-neuf ans auparavant ; une mère attend la visite de son fils, prêtre accusé de pédophilie... Les neuf histoires qui composent « L'Épaisseur des âmes » s'attachent à décrire cette relation élémentaire et si singulière entre les mères et leurs fils. Dans ces neuf face-à-face d une subtilité rare, chacun se livre une bataille cernée de silences et de non-dits, qui modifie fondamentalement leur perception de la vérité. Ces mères et ces fils se sont caché leur vérité intime. Alcoolisme, remords, homosexualité les ont enfermés dans des silences qu'ils ne savent plus rompre... et, alors qu'éclatent la douleur ou la colère, ils passent à côté l'un de l'autre. Un thème commun pour des nouvelles à la portée universelle. Comme dans "Le Maître", le thème central est l'obsession de la dissimulation et l'incommunicabilité entre les êtres. Dans un style délicat au rythme envoûtant, Tóibín explore comme personne l'épaisseur des âmes.
Un Noël en famille – Jennifer Johnston
Porté par l'écriture exquise de Jennifer Johnston, un roman aussi poignant que délicat sur les liens familiaux, l'amour et le temps qui passe. Une histoire bouleversante, parsemée de subtiles références shakespeariennes, par une des plus brillantes romancières irlandaises. Lorsque, après un terrible accident de voiture,  Henry, la cinquantaine, se réveille sur son lit d'hôpital, il ne peut se rappeler ce qui l'a conduit là. Très mal en point, il a du mal à situer ceux qui défilent à son chevet : est-il encore marié à cette femme très autoritaire ? N'était-il pas fâché avec sa fille ? Son fils lui cacherait-il quelque chose ? Son frère serait-il revenu du Canada ? Que devient sa mère, artiste excentrique et déboussolée ? Et qui est Sébastien, ce très bel homme qui le veille nuit et jour ? Au fur et à mesure que son corps se répare, ses souvenirs reviennent, et avec eux ces sentiments d'inadéquation, d'insécurité, d'urgence, qui ont fait tant de tort aux siens. Il faudra encore un peu de temps, un événement dramatique et la magie d'un soir de Noël pour que Henry parvienne enfin à renouer les liens distendus avec sa famille...
Henry, la cinquantaine, se réveille sur son lit d'hôpital, il ne peut se rappeler ce qui l'a conduit là. Très mal en point, il a du mal à situer ceux qui défilent à son chevet : est-il encore marié à cette femme très autoritaire ? N'était-il pas fâché avec sa fille ? Son fils lui cacherait-il quelque chose ? Son frère serait-il revenu du Canada ? Que devient sa mère, artiste excentrique et déboussolée ? Et qui est Sébastien, ce très bel homme qui le veille nuit et jour ? Au fur et à mesure que son corps se répare, ses souvenirs reviennent, et avec eux ces sentiments d'inadéquation, d'insécurité, d'urgence, qui ont fait tant de tort aux siens. Il faudra encore un peu de temps, un événement dramatique et la magie d'un soir de Noël pour que Henry parvienne enfin à renouer les liens distendus avec sa famille...
Charlie – Alain Gerber
Évocation romanesque de l'enfance et de la jeunesse du saxophoniste de jazz Charlie Parker, depuis sa naissance à Kansas City jusqu'à son départ à dix-huit ans pour la gloire. Sous le regard de sa mère Addie et de sa fiancée Rebbeca, et dans l'ombre de Coleman Hawkins, Lester Young et Count Basie, il est alors à la fois tyrannique et crâneur mais aussi capable des pires couacs et objet des huées.
Le rêve de Machiavel – Christophe Bataille
Quelques semaines avant sa mort, à Florence, Machiavel est surpris par la peste. La ville est comme son tombeau. Derrière les palissades, on vit dans la peur, on abandonne ses enfants, on vole du pain gris, on se lave au vinaigre. En quelques heures, l'humanité s'effondre. Sur les bords du fleuve, un prophète réclame des bûchers. Une sorcière tombe en transe. Étrange enfer que cette ville somptueuse, encerclée par les soldats, où se multiplient les meurtres et les viols… Tel est le piège dans lequel se trouve pris le grand penseur politique, l'homme parfaitement civilisé, le voyageur, l'intriguant, l'écrivain. Mis à nu par la maladie, seul, Machiavel garde les yeux ouverts. Sans trop savoir pourquoi, il sauve du bûcher une jeune femme malade…. « Et voici ce que je raconte, après dix années de doute et  d'esquisses : le dernier amour de Machiavel. Comment le penseur tombe amoureux au milieu des corps et des mauvais rêves. Le prince qu'il n'est pas décide de soigner cette femme, il la lave, la dévêt, lui parle, l'embrasse, s'allonge contre elle, contre elle et contre tout, jusqu'au dernier instant…. Je prends Machiavel à son histoire. J'en fais un homme. Pour Machiavel, il a fallu ce long chemin. Il a fallu les voyages, l'exil, il a fallu les livres, les traités, les grandes découvertes, les femmes, la bizarre course du temps pour qu'il ne reste rien : rien du grand esprit, rien de la gloire. Car la peste renverse tout. » Christophe Bataille nous donne un magnifique roman sur la maladie et le néant, qui sonne comme un avertissement : le mal ne se dit pas, et ses formes sont légion. Mais c'est aussi un roman d'amour, car c'est un geste d'amour qui renverse Machiavel et le monde.
d'esquisses : le dernier amour de Machiavel. Comment le penseur tombe amoureux au milieu des corps et des mauvais rêves. Le prince qu'il n'est pas décide de soigner cette femme, il la lave, la dévêt, lui parle, l'embrasse, s'allonge contre elle, contre elle et contre tout, jusqu'au dernier instant…. Je prends Machiavel à son histoire. J'en fais un homme. Pour Machiavel, il a fallu ce long chemin. Il a fallu les voyages, l'exil, il a fallu les livres, les traités, les grandes découvertes, les femmes, la bizarre course du temps pour qu'il ne reste rien : rien du grand esprit, rien de la gloire. Car la peste renverse tout. » Christophe Bataille nous donne un magnifique roman sur la maladie et le néant, qui sonne comme un avertissement : le mal ne se dit pas, et ses formes sont légion. Mais c'est aussi un roman d'amour, car c'est un geste d'amour qui renverse Machiavel et le monde.
Furie – Salman Rushdie
La furie s'est emparée du monde, de New York, du professeur Malik Solanka. Ce dernier a fui l'Angleterre, laissant derrière lui une femme et un enfant, et s'est établi à Manhattan pour «se déprendre et se refaire». Mais recommencer de zéro est tout un art quand on est poursuivi par des spectres, des furies, des souvenirs. Délaissant l'histoire des idées qu'il enseignait dans le Vieux Monde pour la fabrication d'étranges poupées pensantes aussitôt médiatisées, Solanka découvre que d'autres poupées, de sang et de chair celles-ci, subissent la colère d'un mystérieux assassin, le Tueur au panama. Gravitant autour du Professeur, des 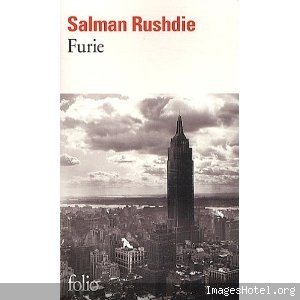 femmes aussi ingénieuses que belles vont tenter de sauver Solanka de cette furie qui le dévore de l'intérieur : la mystérieuse Mila et ses jeux érotiques à la limite du pervers, et la somptueuse Neela, la plus belle femme du monde, qui se sacrifiera au bout de la planète pour que Solanka puisse retourner chez lui, dans l'espoir de revoir son fils... Ce roman s'inscrit avec jubilation dans la lignée de Voltaire et de Swift : Salman Rushdie fonce dans le jeu de quilles de la société moderne, tord le cou à la science sans ménager la fiction. Tour à tour fustigeant et badinant, virtuose et «vitriolique», sagace et cruel, Furie est une fable furieuse, une satire féroce de notre monde actuel, et de la civilisation américaine en particulier.
femmes aussi ingénieuses que belles vont tenter de sauver Solanka de cette furie qui le dévore de l'intérieur : la mystérieuse Mila et ses jeux érotiques à la limite du pervers, et la somptueuse Neela, la plus belle femme du monde, qui se sacrifiera au bout de la planète pour que Solanka puisse retourner chez lui, dans l'espoir de revoir son fils... Ce roman s'inscrit avec jubilation dans la lignée de Voltaire et de Swift : Salman Rushdie fonce dans le jeu de quilles de la société moderne, tord le cou à la science sans ménager la fiction. Tour à tour fustigeant et badinant, virtuose et «vitriolique», sagace et cruel, Furie est une fable furieuse, une satire féroce de notre monde actuel, et de la civilisation américaine en particulier.
La nuit du souvenir – Joseph Bialot
20 ans, ce n'est pas un âge pour découvrir la déportation. 65 ans, ce n'est pas un âge pour y replonger. Et pourtant, Lucien Perrain va y retourner, à " Bonne Espérance ". C'est ainsi que les SS avaient baptisé son camp. Bon voyage, Monsieur Perrain...
Les sœurs – Robert Littell
Frances et Carroll, deux agents de la CIA sur la touche, ont décidé de monter le coup de leur carrière : tuer un politicien américain gênant et faire porter le chapeau à l'URSS. Pour cela, ils ont piégé le Potier, un ancien et redoutable espion du KGB. Bien décidé à se venger et à rattraper son erreur, le Potier débarque aux États-Unis et tente d'empêcher une guerre froide de devenir… brûlante.
Petits crimes italiens – Collectif
Et si le renouveau de la littérature policière venait non pas de Hollywood mais de Cinecittà ?... 10 auteurs, 9 nouvelles - et l'occasion unique de découvrir, grâce à ce 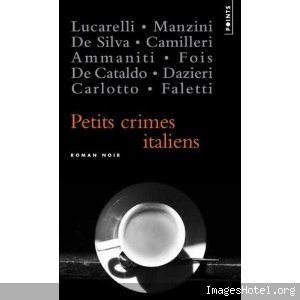 florilège, la formidable vitalité d'un genre trop souvent confiné dans ses codes établis. " Noires ", ces histoires le sont, sans l'ombre d'un doute, et leur suspense n'a rien à envier aux plus terrifiants des " thrillers ". Ici, pourtant, pas de psychopathes cannibales ni de sectes obscures complotant à la destruction du monde, mais des salauds ordinaires, les paumés d'une Italie désemparée, des ordures réalistes - et d'autant plus frappantes ! Ces " petits crimes ", pleins d'humour mais aussi de révolte, marquent ainsi l'avènement d'un genre nouveau : selon Giancarlo De Cataldo, auteur de Romanzo Criminale et maître d'œuvre de cette anthologie, les écrivains ici réunis " ont en quelques années imposé une manière résolument originale de raconter les mythes, les rites, les splendeurs (rares) et les misères (nombreuses) de la réalité contemporaine..."
florilège, la formidable vitalité d'un genre trop souvent confiné dans ses codes établis. " Noires ", ces histoires le sont, sans l'ombre d'un doute, et leur suspense n'a rien à envier aux plus terrifiants des " thrillers ". Ici, pourtant, pas de psychopathes cannibales ni de sectes obscures complotant à la destruction du monde, mais des salauds ordinaires, les paumés d'une Italie désemparée, des ordures réalistes - et d'autant plus frappantes ! Ces " petits crimes ", pleins d'humour mais aussi de révolte, marquent ainsi l'avènement d'un genre nouveau : selon Giancarlo De Cataldo, auteur de Romanzo Criminale et maître d'œuvre de cette anthologie, les écrivains ici réunis " ont en quelques années imposé une manière résolument originale de raconter les mythes, les rites, les splendeurs (rares) et les misères (nombreuses) de la réalité contemporaine..."
Venise, sur les traces de Brunetti – Toni Sepeda
Le commissaire Guido Brunetti, héros des romans policiers de Donna Leon, est le compagnon de promenade idéal dans les labyrinthes de la Sérénissime. Car si les intrigues qu'il résout sont pure fiction, elles sont d'une précision rigoureuse en matière de décor. Conçu autant pour les fans de Donna Leon que pour les simples touristes, le présent ouvrage propose douze itinéraires - d'une durée de une à deux heures - au fil desquels le lecteur s'attachera aux pas d'un natif de Venise, hors des sentiers battus. On  explorera ainsi divers sestieri, comme celui des artistes du Dorsoduro ou celui du Canareggio avec ses calli figés dans le temps, l'on suivra Brunetti de La Fenice - point de départ des premières aventures du commissaire - au célèbre pont du Rialto, ou encore de sa maison à San Polo à la questure de Castello ... Une carte ouvre chaque chapitre pour indiquer l'itinéraire ainsi que ses étapes numérotées - les adresses gourmandes de Brunetti, les lieux cités dans ses enquêtes, ses passages secrets. Avec le Vénitien Brunetti, tout devient compréhensible, plaisant... même l'idée de s'égarer dans cette ville qui, à ses yeux, est la plus belle du monde.
explorera ainsi divers sestieri, comme celui des artistes du Dorsoduro ou celui du Canareggio avec ses calli figés dans le temps, l'on suivra Brunetti de La Fenice - point de départ des premières aventures du commissaire - au célèbre pont du Rialto, ou encore de sa maison à San Polo à la questure de Castello ... Une carte ouvre chaque chapitre pour indiquer l'itinéraire ainsi que ses étapes numérotées - les adresses gourmandes de Brunetti, les lieux cités dans ses enquêtes, ses passages secrets. Avec le Vénitien Brunetti, tout devient compréhensible, plaisant... même l'idée de s'égarer dans cette ville qui, à ses yeux, est la plus belle du monde.
 Une fois n'est pas coutume, après les fêtes de la Noël, suivent les vœux pour la nouvelle année ! Cette fois encore, j'ai voulu faire dans l'humour et la légèreté pour saluer l'année 2011 et dire adieu à une année 2010 pour le moins chargée et particulièrement difficile à plus d'un titre.
Une fois n'est pas coutume, après les fêtes de la Noël, suivent les vœux pour la nouvelle année ! Cette fois encore, j'ai voulu faire dans l'humour et la légèreté pour saluer l'année 2011 et dire adieu à une année 2010 pour le moins chargée et particulièrement difficile à plus d'un titre.