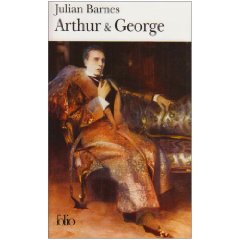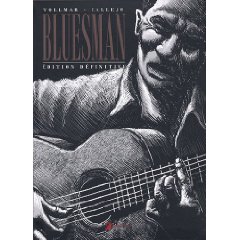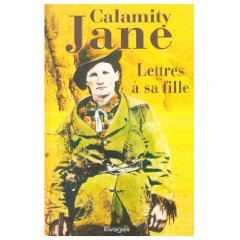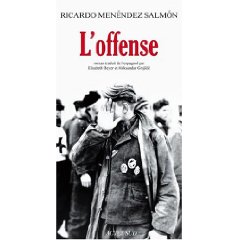- Les trois dames de la Kasbah - Pierre Loti - Folio 2€ n°4446
 La collection Folio 2 € a cela de caractéristique qu'elle permet de lire de bons auteurs avec un choix plutôt éclectique, puisque des écrits de Gandhi côtoient ceux de Sade, de Truman Capote ou de Didier Daeninckx, de Lao She ou de Mishima, de Rilke ou de Jane Austen. Le choix est de plus en plus vaste permettant la redécouverte ou la lecture d'écrivains que l'on n'aurait peut-être pas eu l'intention de parcourir un jour. Personnellement, j'en ai un certain nombre qui attendent dans ma PAL depuis quelque temps. Aussi j'ai voulu vous faire partager un petit voyage en Orient le temps d'une rapide et belle lecture, plus particulièrement entre Alger et Oran, villes remarquables à plus d'un titre. "Les trois dames de la Kasbah" est un recueil composé de deux nouvelles. La première - éponyme - la seconde - "Suléïma" - est un aller-retour incessant et nostalgique entre les charmes de l'enfance et la beauté de l'Orient.
La collection Folio 2 € a cela de caractéristique qu'elle permet de lire de bons auteurs avec un choix plutôt éclectique, puisque des écrits de Gandhi côtoient ceux de Sade, de Truman Capote ou de Didier Daeninckx, de Lao She ou de Mishima, de Rilke ou de Jane Austen. Le choix est de plus en plus vaste permettant la redécouverte ou la lecture d'écrivains que l'on n'aurait peut-être pas eu l'intention de parcourir un jour. Personnellement, j'en ai un certain nombre qui attendent dans ma PAL depuis quelque temps. Aussi j'ai voulu vous faire partager un petit voyage en Orient le temps d'une rapide et belle lecture, plus particulièrement entre Alger et Oran, villes remarquables à plus d'un titre. "Les trois dames de la Kasbah" est un recueil composé de deux nouvelles. La première - éponyme - la seconde - "Suléïma" - est un aller-retour incessant et nostalgique entre les charmes de l'enfance et la beauté de l'Orient.
"Les trois dames de la Kasbah" nous relate les errances de six matelots français en escale à Alger la blanche. Les dimanches de ce mois de mai dans l'air lourd et chaud s'animent de toute cette population bigarrée et cosmopolite qui composent alors Alger en ce 19e Siècle finissant. "[...] toutes sortes de monde s'agitaient : des Français, des Arabes, des Juifs, des Italiens ; des Juives au corsage doré, des Mauresques en voile blanc, des Bédouins en burnous, des spahis, des zouaves [...]". Nos matelots en transit veulent profiter des beautés de l'Orient et surtout de la séduction des orientales. Ils vont se perdre et vagabonder au gré de leurs envies dans le labyrinthe de la Kasbah, à la recherche de femmes vendant leurs charmes. "Il y en avait de toutes sortes, de ces femmes, et plus l'heure avançait, plus les vieilles portes s'ouvraient. Des Mauresques toutes roses, à demi cachées sous des voiles de gaze de soie blanche. Des Juives pâles, aux sourcils minces, au corsage de velours. D'autres qui, pour se prostituer, étaient venues de deux cents lieues dans l'intérieur, des oasis lointaines, et qui avaient d'étranges figures du désert ; - immobiles à leur porte, elles se tenaient les yeux baissés, la voix rauque, avec de hautes coiffures tout en plaques de métal, et de bijoux barbares".
C'est au cœur même de la Kasbah que nos marins rencontrent Kadidja et ses deux filles - Fatma et Fizah - qui se prostituent pour vivre. Entre leurs bras, ils découvriront les envoûtements et les délices de l'Orient, mais aussi les dangers et la violence d'un pays au charme pernicieux. Suléïma" est une étrange nouvelle mêlant subtilement la nostalgie de l'enfance perdue et celle d'une Algérie évanouie, le souvenir d'un amour finissant et celui d'êtres à jamais disparus. Surtout, "Suléïma" est le nom porté par deux êtres chers au cœur de Pierre Loti, une jeune fille d'Oran entrevue et une tortue. "Une tortue, drôle à force d'être petite, un atome de tortue ; son écaille jaune à peine formée, toute couverte de dessins en miniature". Suléïma, enfant d'Oran, suivant son père traînant un bazar portatif contenant des babouches et des colifichets à vendre aux étrangers de passage, fascine Pierre Loti par sa beauté. Pierre Loti, officier de marine, gardera la langueur de l'Algérie, une fois de retour au pays. Sa tortue - Suléïma - sera là pour lui remémorer ses instants de félicité et de bonheur. De retour à Alger, dix ans après, Pierre Loti retrouvera Suléïma - sa petite sauterelle du désert - magnifiée, changée, embellie. "[...] sous ses vêtements libres, elle avait pris la splendeur de lignes des statues grecques, elle s'était épanouie en femme faite et admirable [...] Elle promenait autour d'elle la flamme insolente de ses grands yeux noirs de vingt ans, regardant avec aplomb ces hommes, ayant conscience d'être désirée par eux tous". Pierre Loti deviendra l'amant d'un instant de Suléïma, comme tant d'autres avant lui, car elle vend désormais ses charmes pour vivre. Les choses sont ainsi faites. On se persuade d'aimer, on croit au grand amour, à la fois sublime et divin, et l'on s'aperçoit que celui que l'on achète en passant est - presque - identique. Il n'y a de vrai que l'amour - unique et magnifié - de la mère. "L'amour que l'on a pour sa mère, c'est le seul qui soit vraiment pur, vraiment immuable, le seul qui n'entache ni égoïsme, ni rien, - qui n'amène ni déceptions ni amertume, le seul qui fasse un peu croire à l'âme et espérer l'éternité".
marins rencontrent Kadidja et ses deux filles - Fatma et Fizah - qui se prostituent pour vivre. Entre leurs bras, ils découvriront les envoûtements et les délices de l'Orient, mais aussi les dangers et la violence d'un pays au charme pernicieux. Suléïma" est une étrange nouvelle mêlant subtilement la nostalgie de l'enfance perdue et celle d'une Algérie évanouie, le souvenir d'un amour finissant et celui d'êtres à jamais disparus. Surtout, "Suléïma" est le nom porté par deux êtres chers au cœur de Pierre Loti, une jeune fille d'Oran entrevue et une tortue. "Une tortue, drôle à force d'être petite, un atome de tortue ; son écaille jaune à peine formée, toute couverte de dessins en miniature". Suléïma, enfant d'Oran, suivant son père traînant un bazar portatif contenant des babouches et des colifichets à vendre aux étrangers de passage, fascine Pierre Loti par sa beauté. Pierre Loti, officier de marine, gardera la langueur de l'Algérie, une fois de retour au pays. Sa tortue - Suléïma - sera là pour lui remémorer ses instants de félicité et de bonheur. De retour à Alger, dix ans après, Pierre Loti retrouvera Suléïma - sa petite sauterelle du désert - magnifiée, changée, embellie. "[...] sous ses vêtements libres, elle avait pris la splendeur de lignes des statues grecques, elle s'était épanouie en femme faite et admirable [...] Elle promenait autour d'elle la flamme insolente de ses grands yeux noirs de vingt ans, regardant avec aplomb ces hommes, ayant conscience d'être désirée par eux tous". Pierre Loti deviendra l'amant d'un instant de Suléïma, comme tant d'autres avant lui, car elle vend désormais ses charmes pour vivre. Les choses sont ainsi faites. On se persuade d'aimer, on croit au grand amour, à la fois sublime et divin, et l'on s'aperçoit que celui que l'on achète en passant est - presque - identique. Il n'y a de vrai que l'amour - unique et magnifié - de la mère. "L'amour que l'on a pour sa mère, c'est le seul qui soit vraiment pur, vraiment immuable, le seul qui n'entache ni égoïsme, ni rien, - qui n'amène ni déceptions ni amertume, le seul qui fasse un peu croire à l'âme et espérer l'éternité". Si "Les trois dames de la Kasbah" est une nouvelle avec une morale nette, tranchante et cruelle, "Suléïma" est plutôt une suite de réflexions de Pierre Loti sur la beauté qui - comme l'amour ou la vie - passe, change, mue et disparaît. Si la première est légère, fraîche et avenante, la seconde est plus introspective, plus personnelle. C'est la pensée d'un homme qui a peur du temps qui passe, qui doute de la pérennité de ses sentiments, qui voudrait que rien ne bouge, que tout soit immuable et intemporel ... un peu à l'image de sa tortue Suléïma. Au final, ce sont deux nouvelles à lire pour le plaisir des descriptions des lieux et des personnages, véritables tableaux à la Delacroix, même si l'écriture de Pierre Loti peut sembler désuète et dépassée. Pour rêver et s'inviter au voyage, le temps de la lecture.
Si "Les trois dames de la Kasbah" est une nouvelle avec une morale nette, tranchante et cruelle, "Suléïma" est plutôt une suite de réflexions de Pierre Loti sur la beauté qui - comme l'amour ou la vie - passe, change, mue et disparaît. Si la première est légère, fraîche et avenante, la seconde est plus introspective, plus personnelle. C'est la pensée d'un homme qui a peur du temps qui passe, qui doute de la pérennité de ses sentiments, qui voudrait que rien ne bouge, que tout soit immuable et intemporel ... un peu à l'image de sa tortue Suléïma. Au final, ce sont deux nouvelles à lire pour le plaisir des descriptions des lieux et des personnages, véritables tableaux à la Delacroix, même si l'écriture de Pierre Loti peut sembler désuète et dépassée. Pour rêver et s'inviter au voyage, le temps de la lecture.
"Les trois dames de la Kasbah" de Pierre Loti a été une relecture dans le cadre du challenge de Marie L. :

 301 - 1 = 300 livres dans ma PAL ... Vive les challenges et autres lectures communes !
301 - 1 = 300 livres dans ma PAL ... Vive les challenges et autres lectures communes !